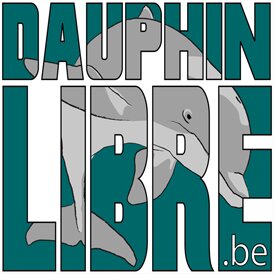Deux dauphins communs ont survécu à l’échouage de 80 des leurs. Ils vont être remis en mer, mais en ont-ils envie ? Photograph: Julia Cumes/AP
Suicide et échouage : le choix de la mort chez les dauphins
Is dolphin suicide real ? The stories and science suggest that it is.

L’amitié homme-dauphin était célébrée par les Grecs
Dans son livre « Naturalis Historiae » publié dans les années 77-79 AD, le naturaliste grec Pline l’Ancien décrit une amitié touchante entre un dauphin et un jeune garçon. Selon le récit de Pline, les deux amis passaient de nombreuses heures à s’amuser ensemble dans la mer.
Malheureusement, cette relation eut une fin abrupte lorsqu’un jour, tandis qu’il se tenait sur le dos du dauphin, une tempête renversa le garçon et le noya dans les vagues. Le dauphin ramena le corps inanimé sur le rivage et, selon Pline, «le dauphin, conscient de qu’il avait causé de la mort de son ami, ne retourna pas vers la mer et se laissa mourir sur la plage ».
Pline poursuit en disant qu’un autre scribe nommé Théophraste avait noté le même type d’évènement à Nafpaktos.
Le mot «suicide» semble être le plus approprié pour décrire cet échouage.
Pourtant, certains émettent encore des doutes sur le fait qu’un dauphin, ou tout autre animal, puisse décider de se donner la mort. Parce cet acte implique des processus émotionnels et personnels profondément complexes, nous supposons que le suicide constitue un autre pilier de la structure grandiose de l’exceptionnalisme humain. Mais si l’on regarde les incidents d’échouage et que l’on explore les motivations sous-jacentes potentielles, nous pouvons glaner des idées dans l’esprit des cétacés et dans leurs cultures complexes et innombrables. Et nous pourrions apprendre quelque chose sur notre propre nature en parcourant ce chemin.
Echouages
Alors que le compte-rendu de Pline reste l’un des premiers témoignages à propos d’un échouage de cétacé, ce type d’incidents reste monnaie courante aujourd’hui. Des rapports nous arrivent constamment du monde entier: en avril 2015, 160 baleines à tête de melon se sont échoués vivantes sur une côte du Japon.
En Inde, 81 globicéphales se sont également échoués.
Bien que les raisons pour lesquelles les cétacés s’échouent restent souvent un mystère, nous savons que certaines espèces sont plus sujettes à l’échouage que d’autres.
Certains des incidents les plus énigmatiques impliquent des clans entiers de dauphins s’échouant en masse, tous en bonne santé sauf un seul individu malade ou blessé.
Dans certains cas, l’échouage s’explique facilement, notamment lorsqu’on découvre des signes de maladies, de blessures ou d’infections. Parfois, c’est la pollution générée par les humains qui est à blâmer. L’une des principales causes d’échouages est l’usage par la marine militaire et les prospecteurs de pétrole de canons sonores et d’ultrasonars.
Ces dispositifs font exploser le système acoustique des cétacés en pièces, provoquant des milliers de décès par an.
Parfois, cependant, une cause ne peut être déterminée.
Dans ces cas, les explications officielles sont nombreuses, mais semblent insuffisantes : les cétacés peuvent avoir été chassés hors de l’eau par un prédateur. Ou bien encore, la topographie océanique aurait pu les tromper. Ou bien les conditions météorologiques n’étaient pas bonnes…
Malgré que les humains soient la cause de nombreux échouages, le récit de Pline nous montre que les cétacés s’échouaient déjà bien avant que nous ne commencions nos activités perturbatrices. Que penser des échouages d’individus apparemment en bonne santé, qui se hissent sur la terre pour y mourir ?

Une mort atroce. Photo Julia Cumes / AP
Un acte intentionnel
Même si elles peuvent être valides dans certains cas, les explications officielles tiennent rarement en compte, sinon jamais, la possibilité d’une prise de décision autonome par les cétacés eux-mêmes.
Cet oubli vaut d’être analysé.
Les dauphins peuvent contrôler de nombreux aspects de leur physiologie qui ne sont chez nous que des mécanismes physiologiques inconscients, de la même manière, pourrait-on dire, qu’un conducteur se sert d’un changement de vitesse à la main ou bien roule en automatique.
Chaque souffle qu’ils prennent est un effort conscient et coordonné. Les mâles peuvent exhiber ou faire disparaître leur érection sur simple commande. On a également spéculé que les femelles étaient en mesure de choisir quel sperme de quel amant fertilisera son ovule. Aussi, n’est-il pas si étrange de penser que les dauphins puissent décider de mettre fin à leurs jours.
Certaines personnes nient la capacité des cétacés à se suicider parce qu’ils pensent que les dauphins n’ont un cerveau suffisamment puissant pour cela.
Pourtant, un nombre croissant de scientifiques n’est pas d’accord avec ce point de vue. C’est le cas du Dr Lori Marino.
Dans son article, « Le suicide chez les dauphins: une possibilité ? » le docteur Marino souligne qu’un faisceau de preuves s’accumulent qui indiquent l’existence d’une conscience de soi chez le dauphin, mais aussi d’une capacité à réfléchir à propos de lui-même et des actes qu’il planifie sur le long terme.
Ce qui implique clairement qu’il est en mesure de poser des actes intentionnels tels que le suicide.
Pline n’est pas le seul à faire allusion au caractère intentionnel de ces décès.
Dans un environnement humain contrôlé – à savoir la captivité – de nombreux récits attestent de suicides apparents de cétacés. Dans certains cas, on pense que le dauphin referme simplement son évent et refuse de reprendre son souffle. Peut-être font-ils cela plutôt que de s’échouer, parce qu’ils ne bénéficient pas de cette option dans les bassins des delphinariums. L’asphyxie volontaire semble certainement un moyen préférable pour mourir, et peut-être est-elle pratiquée en mer aussi.
Il est important de garder à l’esprit que, même si cela n’a pas encore été observé en milieu naturel, cela ne se produit jamais.

Ric O’Barry et la delphine Kathy, dont le suicide n’est qu’une exemple parmi de trop nombreux autres…
Pline était moins équipé que nous en connaissances scientifiques à propos du comportement des dauphins et de leur physiologie.
Néanmoins, il insinue clairement que l’échouage qu lui a été rapporté était un acte de suicide délibéré. Il se moquerait sans doute de nos explications scientifiques contemporaines, soi-disant « objectives », qui voudrait qu’il s’agisse d’une pure coïncidence ou que le dauphin se comporte seulement comme s’il confessait du crime. Au lieu de cela, Pline se demandait si la motivation de ce suicide était causée par le deuil d’un ami humain, ou par une forme d’autopunition ou par une combinaison des deux. Bien que nous ne saurons jamais la réponse, il y avait apparemment peu de doute dans l’esprit de Pline que cet échouage était bien un acte intentionnel, motivé par ce qui avait être un assaut implacable d’émotions douloureuses.
L’échouage volontaire n’est certainement pas une décision que le dauphin prend à la légère.
La mort d’un cétacé sur la terre ferme est un processus lent et douloureux. Le malheureux peut littéralement cuire à mort au soleil, si la journée est une chaude. Dans les climats plus froids, la force de gravité écrase lentement mais sûrement écrase les organes internes du cétacé sous le poids de son propre corps. Dans tous les cas, ils ont tout le temps nécessaire pour contempler leur propre agonie. La pensée d’une telle mort est probablement ce qui a conduit à penser qu’elle ne pouvait pas être volontaire chez les cétacés.
Indépendamment de la méthode utilisée, beaucoup d’entre nous peuvent se reconnaître dans cette volonté de contrôler le moment et les circonstances de sa propre mort.
On peut dire que c’est un droit fondamental chez l’homme. Pourtant, dans les cultures occidentales tout au moins, on a plutôt tendance à prolonger la vie à tout prix – ce qui entraîne souvent une souffrance profonde et inutile. Aux yeux des grandes religions comme le christianisme et l’islam, le suicide humain est traditionnellement considéré comme un péché et il reste illégal dans de nombreux pays. Le Royaume-Uni continue à refuser à ses citoyens le droit de mourir. Aux États-Unis, seule une poignée d’Etats permettent aux gens de prendre cette décision, y compris l’Oregon avec leur récente loi Death with Dignity Act. Alors que les appels à donner librement le droit de mourir sont de plus en plus forts, il y a encore du chemin à faire.
On peut se demander ce que les dauphins penseraient de cela.
Départ collectif
Bien que les membres de notre propre espèce peuvent prendre, comme les dauphins, la décision de mourir, il existe peu de cas de sociétés humaines qui partageraient la tendance au suicide collectif des cétacés (en supposant que certains échouages de masse sont, de fait, des suicides).
Les autopsies menées sur les corps des dauphins morts en groupe révèlent souvent qu’un seul membre du pod était malade, et tous les autres en bonne santé.
En août 2015, en la Nouvelle-Écosse, 14 globicéphales se sont échoués, dont un seul membre est en mauvaise santé. L’explication donnée à cette situation est que les baleines pilotes auraient mal évalué les marées et se seraient laissé piégé. Sommes-nous vraiment en mesure de croire que cette espèce, équipé de ce qui est probablement le système sensoriel le plus sophistiqué de la planète, puisse se tromper aussi grossièrement ? Peut-être.
Mais peut-être aussi que l’histoire est plus complexe.
Parce que leur sonar permet au dauphin de pénétrer la surface des corps, les dauphins sont capables d’observer le début d’une maladie grave chez un compagnon.
On sait qu’ils sont capables de détecter un cancer et d’autres maladies chez les humains, et font preuve alors d’une compréhension et d’une préoccupation appropriée à l’égard de la santé de l’être humain. De telles anecdotes semblent suggérer que les dauphins surveillent la santé des autres. Si cela est vrai, ils pourraient avoir une meilleure compréhension du moment où le décès risque d’avoir lieu et peut-être même celui où il suivront le défunt tous ensemble.
Suggérer qu’une tribu de dauphins puissent avoir le courage d’affronter la mort d’une manière aussi délibérée, et qu’elle choisisse de le faire à la perspective de perdre l’un de leurs proches, reste une question controversée.
Cela ne veut pas dire que toutes les sociétés de dauphins le font ou qu’ils s’associent toujours pour le faire. Dans certains cas, lorsqu’un dauphin tombe malade ou récupère après une attaque de requins, il restera à l’écart du groupe jusqu’à ce qu’il soit guéri.
Mais l’échouage de pods entiers de dauphins en bonne santé, dont un seul membre est malade, soulève des questions intéressantes. Compte tenu de la taille et de la structure de leur système limbique, la douleur émotionnelle de devoir vivre sans un membre de leur tribu pourrait être trop lourde à supporter. Pour les dauphins, la douleur physique pâlit sans doute au regard des blessures émotionnelles.
Partout où les cétacés s’échouent, notre instinct nous pousse à leur venir en aide.
Nous avons des réseaux spécialisés dans ces incidents, qui font le noble travail de remettre en mer les mammifères marins. Mais ces bonnes actions sont entièrement fondées sur nos constructions morales humaines, guidées par l’idée que nous savons toujours ce qui est mieux pour les autres. Nous supposons que les cétacés veulent que nous fassions tout notre possible pour leur éviter l’inéluctabilité d’une mort horrible. À vrai dire, nous ne pouvons pas savoir avec certitude si ces dauphins désirent retourner dans l’eau.
Une grande partie de notre aversion pour la mort est fondée sur notre angoisse de l’inconnu.
Voilà pourquoi nous tenons à notre propre vie – à celle e nos proches – de manière parfois irrationnelle alors qu’il serait plus humain de laisser aller les choses. Faisant face à la mort perçue comme à une fatalité, la percevoir comme quelque chose de naturel et de normal pour tout être étant né, n’est pas quelque chose sur lesquelles nos cultures modernes ont tendance à mettre l’accent.
Cela pourrait être sur ce point que notre espèce diffère le plus des cétacés.
Auraient-ils une vision tout à fait différente de la mort, et donc de la vie, que nous ? Pourraient-ils considérer la mort non pas comme quelque chose à craindre, mais quelque chose à faire, ensemble, avec leurs proches? Sont-ils pas peu attachés à leur individualité et donc peu effrayés de le perdre ?
Cela pourrait aussi expliquer en partie la raison mystérieuse pur laquelle des dauphins refuse de sauter par-dessus les filets à Taiji ou de repousser leurs assaillants.
Peut-être voient-ils la fin non pas comme quelque chose à craindre, mais comme quelque chose à faire ensemble. Si tel était le cas, les pêcheurs forçant une poignée d’individus traumatisés de retourner à la mère après le massacre, et de garder les autres pour une vie en captivité, infligent alors à leurs victimes des peines encore plus cruelle que nous pouvons l’imaginer.
D’une certaine manière, l’échouage est comme une naissance humaine à l’envers.
La composition du liquide amniotique de l’utérus chez les mammifères et presque identique à celle de l’eau de mer. Les cétacés sont nés dans l’océan interne de leur mère, mais aussi dans l’utérus collectif de la mer, sans jamais toucher la terre ferme de toute leur vie sauf, parfois, tout à la fin. Intentionnel ou non, l’échouage est une représentation de la nature cyclique de l’existence, une renaissance ultime.
Nous ne pouvons jamais savoir pourquoi les cétacés meurent de la façon dont ils le font.
Mais les questions qui se posent devrait obliger chacun de nous à repenser la façon il perçoit la mort. Peut-être n’est-elle pas à craindre, en effet. Après tout, n’est-elle pas la chose la plus naturelle du monde ?
D’après l’article de Sonar
Deciding To Die: Dolphin Suicide