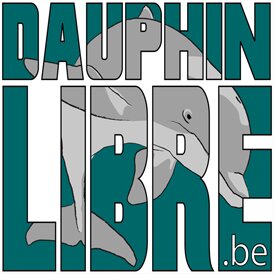Planckendael-Pairi Daiza : sanctuaires ou fermes à éléphants ?
Planckendael et Pairi Daiza : sanctuaires ou fermes à éléphants ?
La question ne se pose pas pour la presse :
« Pour les touristes, la visite de l’enclos des éléphants est une attraction majeure de leur passage au parc mais pour Rob et son équipe derrière cette façade, c’est surtout un sanctuaire à préserver ! » s’extasie un journaliste à propos de Pairi Daiza.
De son côté, Planckendael parle de « crèche », de « famille » et de « groupe d’élevage » lorsqu’il annonce aux médias la naissance de son nouvel éléphanteau le 12 avril 2018 :
« L’éléphant d’Asie Phyo Phyo, la maman de Kai-Mook, est devenue maman pour la sixième fois ! À l’instar de ses cousines Suki et Tun Kai, ce troisième bébé de la famille est né dans l’écurie de sable de Planckendael, entouré de la famille éléphant. La famille éléphant compte désormais dix spécimens dont quatre jeunes. Avec trois bébés et un jeune, on peut parler de véritable crèche pour éléphants à Planckendael ».

Pairi Daiza. L’espace se prolonge sur la même distance de l’autre côté du plan d’eau. C’est énorme, mais un peu vide.
Quand on regarde les enclos de Pairi Daiza, le spectacle est à couper le souffle
C’est immense, démesuré, du jamais vu en Europe. Dix-huit éléphants vivent ici, nous dit-on, deux naissances viables y ont eu lieu et une grossesse est annoncée. On ne peut que se réjouir de l’arrivée successive de ces éléphanteaux en deux ans, ce qui est un véritable exploit pour les zoos mais surtout, un bonheur pour les éléphantes. Chez elles, c’est le règne de l’enfant-roi. Il faut voir ces gosses se rouler dans le sable, riant à leur manière, ignorant tout de leur sort d’exilé. Ils s’amusent et les adultes aiment les regarder jouer.
Il en va de même à Planckendael.
On avait parlé d’un stade de football à propos de son enclos et de ses étables, les plus grands d’Europe avant que Pairi Daiza ne se lance dans la course. L’espace semble désormais un peu plus petit qu’en Hainaut, plus contourné, mais à ce titre, il ménage de nombreux recoins dans les « collines » où des groupes peuvent s’isoler.
Et bien sûr, comme à Pairi Daiza, le public fond devant le spectacle somme toute assez nouveau de ces éléphanteaux coiffés d’une touffe de poil, à la petite trompe encore indisciplinée, qui suivent leur maman partout où elle va où se roule dans le sable avec une grande soeur.
Quand on se souvient de la minuscule plate-forme extérieure, sans sable ni eau, à l’extérieur du Temple égyptien du zoo d’Anvers en 1960, où les éléphants tendaient leur trompe aux visiteurs et recevaient biscuits et cigarettes, avant de mourir rapidement dans d’horribles souffrances sur leurs jambes arthritiques, on mesure tout le chemin parcouru.
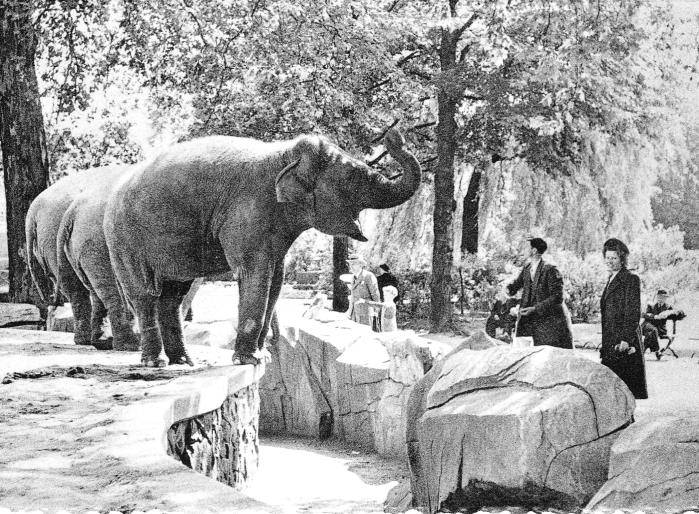
Le Zoo d’Anvers après la guerre 40
A Planckendael et à Pairi Daiza, les populations sont différentes.
Presque homogène et birmane en Flandre, puisque le groupe fondateur est arrivé de Port Lympne en urgence pour fuir l’épidémie d’herpès, elle est beaucoup plus hétéroclite à Pairi Daiza, car les groupes intègrent des éléphants d’Afrique et d’autres d’Asie, dont certains sont issus du cirque. Le parc accueille aussi d’autres cas difficiles, telles Jana et Praya, gravement traumatisées par leurs transferts et leurs deuils.
On se réjouit aussi d’y revoir Suzy et Gitana toujours inséparables et en bonne santé.
Alors que toute stéréotypie semble avoir disparu chez les éléphants de Planckendael, même chez la vieille Dumbo qui en a tant vu et chez la fragile Yin Yin marquée d’une étoile au flanc, ce n’est pas le cas dans le parc hennuyer.
Ici, certaines éléphantes restent encore vivement affectées par des syndromes stéréotypiques, dansant sur place et balançant la trompe au rythme de leur cirque intérieur. C’est une bonne chose de les avoir tiré de là et de poursuivre ce genre de sauvetage.
Quoiqu’il arrive, ces éléphantes ne peuvent que se reconstruire loin des pistes.
Cela dit, comme pour les dauphins, le maintien en vie d’une population d’éléphants « ex situ » pose problème, car ils meurent plus vite que leurs homologues libres et se reproduisent moins.
«L’espérance de vie des éléphants est beaucoup plus faible dans les zoos que dans leur milieu naturel.
Leur santé est fragilisée par la captivité et les populations des zoos doivent être maintenues par de nouveaux arrivants, faute de reproduction. Le sort de 786 éléphants – africains ou asiatiques- hébergés par des zoos européens avec des éléphants d’Afrique (Loxodonta africana) a été comparé à celui des individus vivant dans le cadre protégé du parc d’Amboseli, au Kenya, et à celui des éléphants d’Asie (Elephas maximus) utilisés dans les forêts de Birmanie pour l’exploitation du bois.
Il ressort de l’analyse des chercheurs que les femelles Loxodonta africana vivent 56 ans en moyenne à Amboseli et moins de 17 ans dans les zoos. L’espérance de vie des femelles Elephas maximus est de 19 ans dans les zoos et de 41,7 ans pour les éléphants birmans transporteurs de grumes. Surtout, la mortalité des jeunes est plus élevée dans les zoos, selon les chercheurs, et elle est aggravée par les transferts d’animaux qui séparent les petits de leurs mères ».
En outre, les éléphants captifs souffrent de privation sociale et sensorielle, car l’univers de la captivité est toujours infiniment plus pauvre qu’un environnement naturel. Du moins, jusqu’il y a peu.

Africa, un ancien détenu de Bouglione, contemple le vide depuis des années dans la même position au même endroit au Monde Sauvage d’Aywaille
Avec des décennies de retard, les grands zoos modernes tentent aujourd’hui de réunir des hardes de plus en plus grandes, comptant plus de dix éléphants.
On pourrait même aller jusqu’à quarante par groupe ! Exhiber un éléphant solitaire ou un seul couple est désormais dénoncé comme une maltraitance. De même, les enclos en béton où les pachydermes éléphants se mourraient perclus d’arthrose et de pneumonie ne se trouvent plus que dans les petits zoos les plus minables, ou hors d’Europe.
Nos captifs vivront donc plus longtemps et auront davantage d’enfants, comme nous l’indique la tendance actuelle.
Ni Pairi Daiza ni Planckendael ne sont cependant extensibles à l’infini.
Au-delà d’un certain nombre d’éléphants, il va falloir se séparer du surplus, au prix de séparations déchirantes, et l’expédier vers des zoos moins bien équipés au prix de voyages traumatisants et de réadaptations pénibles à un nouvel environnement social. Beaucoup d’éléphants n’y ont pas résisté et sont morts avant ou après le transport en camion.
Et c’est ce qui gâche le spectacle, si l’on peut dire, à qui sait se projeter dans le futur.
Car au-dessus de ce bonheur apparent, flotte comme une épée de Damoclès les cruels programmes de reproduction EEP.
En son nom et au nom de la préservation d’un «capital génétique » jugé plus précieux que les individus, les jeunes éléphantes sont mises enceinte dès la puberté.
Ani a été engrossée à 7 ans et Kai-Mook à 8 ans, ce qui est l’âge le plus précoce possible en milieu naturel. Ces grossesses hâtives, tant désirées par les gestionnaires des parcs, créent parfois des situations atroces, comme la lente agonie de Baby Q, l’enfant de May Tagu.
En liberté, la plupart des femelles n’accouchent de leur premier enfant que bien plus tard, vers 14-15 ans, quand elles sont acquis suffisamment d’expérience aux contact de leurs aînées. Plus les mères sont âgées, plus elles font de bonnes mères et il n’est pas rare de voir des éléphantes âgées de 50 ans qui restent encore fertiles.
D’autres, comme Roxanne chez les dauphins captifs, se transforment en «breeding cows».
C’est le cas de Khaing Phyo Phyo à Planckendael. La maman de Kai-Mook a donné naissance à son sixième enfant en avril 2018.
En juin 1989, elle avait été arrachée à sa propre mère en Birmanie par le trafiquant Frans van den Brink. De là, Phyo Phyo fut amenée au Rhenen Zoo, puis au Rotterdam Zoo le 9 novembre 1995. Elle fut ensuite expédiée au Port Lympne Zoo en Grande Bretagne en 1999, avant d’arriver au Zoo d’Anvers en 2006, puis à Planckendael.
Dans l’intervalle, cette remarquable « vache reproductrice » avait donné naissance à cinq enfants, tous laissés derrière elle. Son fils Sitang est né en 2002. Il est mort à 3 ans le 15 juillet 2005, frappé par le virus de l’herpès. Son autre fils, Timber, lui a été retiré à 4 ans. Elle ne l’a jamais revu.
Khaing Phyo Phyo est-elle aujourd’hui à l’abri de nouveaux déplacements, de nouvelles ruptures, de nouvelles grossesses jusqu’à l’épuisement ?
Qui peut le dire ?
Les zoos veillent aujourd’hui à ne pas briser des amitiés anciennes entre les éléphantes, car beaucoup ne survivent pas au chagrin.
Mais rien n’est stable dans cet univers. Un zoo peut être ruiné, vendu, racheté, tout peut arriver dans le monde économique. Le zoo d’Amiens vient d’en donner la preuve en se débarrassant de ses deux vieilles éléphantes, dont on ne sait que faire !
Quant aux mâles nés captifs, leur sort est encore moins enviable…
« Kanvar est actuellement le mâle reproducteur de service » déclare gaiement le site du zoo d’Anvers.
Nous avions vu le petit Kanvar enfant, partageant son enclos minuscule du Zoo d’Anvers avec d’autres jeunes mâles de passage.
Né en 2008 au Selwo Aventura Costa Del Sol en Espagne, Kanvar a quitté sa mère Samicuta, aujourd’hui décédée, pour rejoindre Anvers en 2013 puis Planckendael en 2017.
Désormais, il n’a même plus d’ami. Il est seul dans son enclos, séparé des femelles par un haut mur de béton blanc. Restera-il à Planckendael ? Chang l’a déjà précédé et d’autres suivront sans doute, pour étoffer le fameux capital génétique du groupe d’élevage. Il commence tôt, puisqu’il n’a que dix ans, mais ses talents de reproducteur risquent d’être réclamés par de nombreux autres zoos.

Ming Ju et Kanvar (à droite) encore enfants au Zoo d’Anvers
A Pairi Daiza, ce sont Chamundi et Po Chin qui assurent la reproduction.
Chamundi est né en Allemagne en 1992 au Tierpark Hagenbeck d’Hambourg, qu’il quitte lui aussi à l’âge de 4 ans ! Il passe ensuite par l’Allwetterzoo de 1996 à 2011, avant de se retrouver à Bellewaerde de 2011 à 2014 puis enfin à Pairi Daiza.
Po Chin, lui, est né en 200 au Chester Zoo, en Grande Bretagne.
Toujours à 4 ans, il est envoyé au Bellewaerde Park, jusqu’en 2010 et de là, à Pairi Daiza. Son compagnon Fahim est resté sur place et se trouve toujours à Ypres. Totalement seul.
Leurs voyages s’arrêteront-ils là ? Qui peut le savoir ?
Khin et Valentino, deux autres éléphants mâles de Pairi Daiza ne sont-ils déjà partis en 2014 pour Heidelberg et Berlin ?

Fahim, le compagnon de Po Chin, seul à Bellewaerde
En liberté, les éléphants mâles commencent à montrer les débuts de l’indépendance seulement vers huit ou neuf ans.
Et ce n’est pas encore le grand départ ! Ils peuvent passer un jour ou deux loin de leur famille, pour y revenir en courant !
Pendant leurs années d’adolescence, un jeune mâle reste généralement à la marge de son groupe natal. Ils se promènent souvent assez loin pour trouver des partenaires de jeu dans d’autres familles. Grâce à ces interactions ludiques, le jeune mâle peut mémoriser la taille et la force de ses camarades du même âge, auxquels ils se mesurera en combat chevaleresque à l’age adulte.
Les jeunes s’intéressent également aux activités des mâles plus âgés, qu’ils suivent et regardent agir. Vers 14 ou 15 ans, la plupart des jeunes adultes passent la majeure partie de leur temps avec d’autres familles ou en groupes mixtes.
La spermatogenèse (la formation de spermatozoïdes) a lieu vers l’âge de 10 ans, mais les mâles ne produisent pas de spermatozoïdes en quantités suffisantes avant l’âge de 17 ans. Ces jeunes mâles montrent de l’intérêt pour les femelles en oestrus mais leur petite taille et leur faible rang social les rendent incapables de rivaliser avec succès avec les grands mâles pour y accéder.
Ils doivent traverser une période prolongée de croissance et de développement social avant de pouvoir rivaliser avec des mâles plus grands, plus âgés et plus expérimentés.
Les éléphants mâles n’atteignent leur pic de reproduction qu’entre 40 et 55 ans et ils sont toujours très actifs sur ce plan à l’âge de 60 ans !
Ce n’est donc pas tout à fait le même genre de vie que les zoos leur proposent.
Loin d’être des sanctuaires, ces deux parcs belges sont des fermes à éléphants, destinés à alimenter les autres zoos.
Comme disait cruellement Lori Marino à propos des sanctuaires marins pour cétacés de cirque : « Dans un parc marin, le bien-être des animaux n’est jamais la priorité. Ces établissements commerciaux doivent d’abord se préoccuper de la satisfaction des leurs visiteurs et de la vente des billets. Dans un sanctuaire, le bien-être des cétacés est la priorité absolue. Toute l’entreprise se concentre sur ce but ».
De vrais sanctuaires pour éléphants, on en trouve au Tenessee, par exemple. On en trouvera bientôt en France si l’industrie de la captivité n’y fait pas obstacle, et malgré le mépris des zoos à l’égard de cette aventure, pourtant menée par un couple d’anciens soigneurs du Zoo d’Anvers.
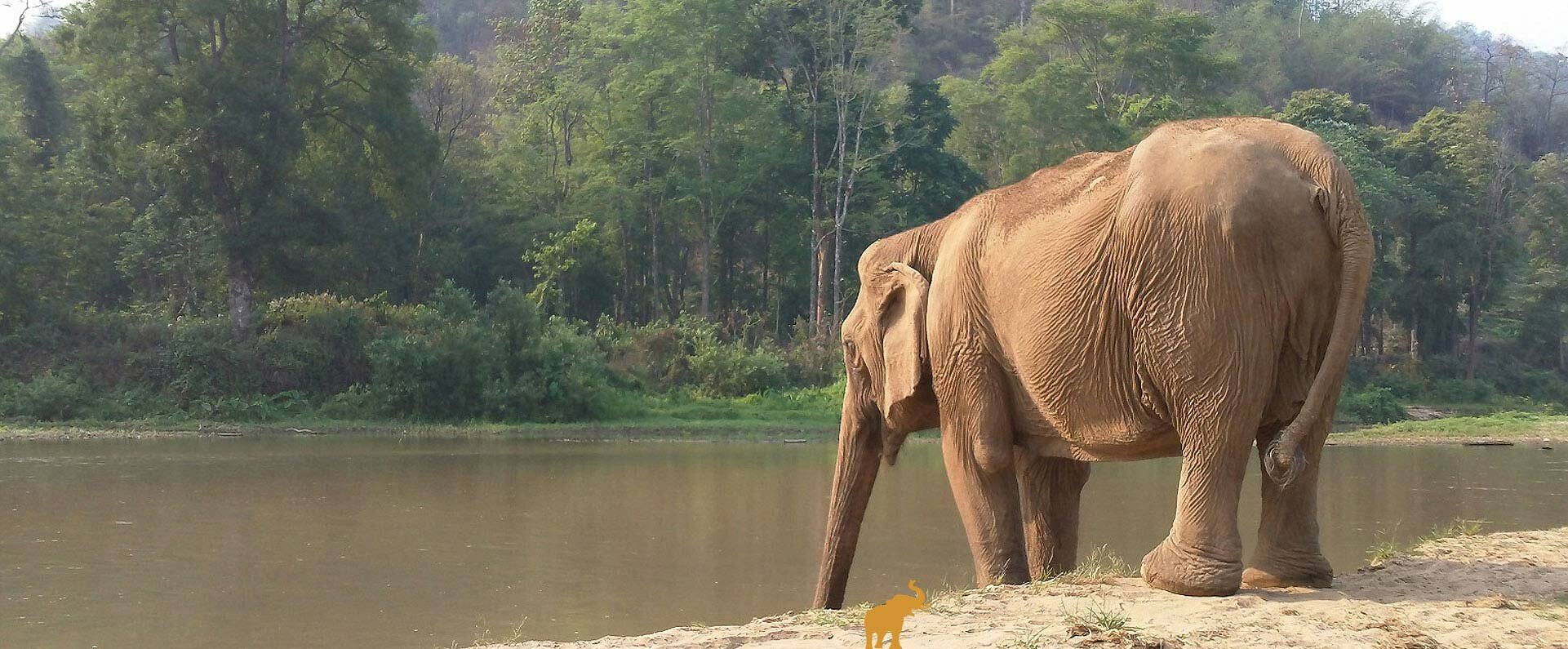
Elephant Haven sera destiné aux éléphants de cirque maltraités
Alors, ne trompons pas les gens sur la marchandise, car il s’agit bien de cela.
Pairi Daiza et Planckendael font sans nul doute le bonheur des éléphants qui s’y trouvent, car ils n’ont jamais connu cela. La vieille Dumbo en particulier doit être particulièrement surprise de tant d’espace, d’amies et d’enfants autour d’elle, après l’enfer qu’elle a vécu.
Mais les zoos restent des prisons de haute sécurité où la vie de chaque animal, de l’alimentation à la reproduction, de la naissance à l’euthanasie, est entièrement contrôlée par l’homme, sous la contrainte d’une pure logique économique. Seuls les grands zoos peuvent d’ailleurs s’offrir le luxe d’accueillir des hardes de plus de 10 individus.
« En an 2000, 481 éléphants étaient maintenus en captivité dans 135 zoos autour du monde. Un cinquième de ces zoos ne possédaient qu’un seul éléphant et presque un tiers d’entre (31%) n’en détenaient que deux. Plus de 80% de ces zoos ne possèdent que de petits troupeaux composés de cinq animaux maximum. Les plus grands troupeaux regroupent 15 éléphants, au Zoo d’Emmen (Pays Bas), au zoo de Karl Hagenbeck (Allemagne) et à l’Hawthorn Corporation (Etats-Unis)« .
On a longtemps fait peu de cas des besoins sociaux et affectifs des éléphants captifs.
Aujourd’hui encore, comme pour les dauphins, leur intelligence, leurs cultures et leur organisation sociale sont rarement mis en avant par les zoos. Ceux-ci détiennent pourtant dans leurs parcs d’attraction envahie de poussettes et d’enfants en bas âge, les plus puissants cerveaux du monde, avec l’homme et le dauphin.
C’est pourquoi le vrai combat pour les éléphants se passe ailleurs, en Asie et en Afrique.
Tous ne sont pas encore morts là-bas, loin s’en faut. Aussi faut-il aider d’abord ceux qui se battent sur place.
Planckendael soutient bien un projet en Inde depuis 2009 et Pairi Daiza un autre, moins bien défini, dont le but est de vaincre l’herpès, une maladie affectant surtout les éléphants captifs.
Nulle part dans ces deux zoos, mention n’est faite nulle part du travail remarquable de gens directement actifs sur le terrain, telles que le David Sheldrick Wildlife Trust, le Jane Goodall Association ou les Rangers du Virunga National Park. Ces gens qui ne tentent pas seulement de préserver un « capital génétique menacé » en vendant des pandas en peluche à la sortie, mais qui veulent aussi sauver, tant qu’il en est encore temps, les savoirs anciens transmis de génération en génération par de sages matriarches et que les zoos détruisent…

Pendant ce temps-là, deux éléphanteaux restent au Zoo d’Anvers…