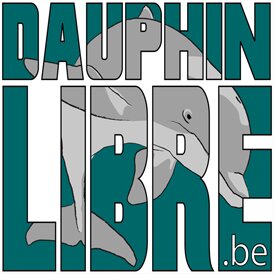Mourir au delphinarium
Impossible de faire la liste ici de toutes les maladies spécifiques aux bassins qui déciment les cétacés.
Il en existe plusieurs répertoires vétérinaires mais on trouve les causes de ces décès dans les rapports d’autopsie parfois livrés par les delphinariums ou dans les études spécialisées. En revanche, une chose est sûre : pour la plupart, ces maladies sont de type nosocomial, c’est à dire causées par le milieu hospitalier aux patients qu’il prétend soigner.
Il en va de même des infections, des suicides ou des accidents qui adviennent aux cétacés captifs et qui sont générés par les delphinariums eux-mêmes.
En liberté, on meurt aussi, bien sûr, mais à d’autres moments de la vie et le plus généralement lors de rencontres avec une hélice de bateaux, suite à l’ingestion de sacs en plastique, à l’empoisonnement du à la pollution ou aux infections parasitaires massives, notamment.
Nous allons passer en revue ici, de manière non-exhaustive, quelques unes des causes de décès les plus classiques en delphinarium, illustrées chaque fois par un cas réel.
Tilikum et la pneumonie
«La cause principale des décès chez les mammifères marins en captivité (autres que les ours polaires) est la pneumonie. La plupart des cas de pneumonie des mammifères marins se caractérisent par une importante infection bactérienne.
La pneumonie est souvent le résultat d’une mauvaise gestion des bassins, mais quand bien même les animaux captifs sont soigneusement gérés, la mortalité liée à la pneumonie reste fréquente.
Les mammifères marins exigent une bonne qualité de l’air, y compris un taux élevé de renouvellement d’air à la surface de l’eau dans les installations couvertes. L’air tempéré ou l’acclimatation au froid est également important pour prévenir les maladies pulmonaires, même pour les espèces polaires. Les animaux acclimatés à des températures froides sont habituellement assez robustes. Cependant, la transition soudaine d’un milieu chaud à l’air froid, même dans de l’eau plus chaude, peut précipiter les pneumonies fulgurantes, en particulier chez des animaux qui se nourrissent mal ou qui sont affaiblis pour d’autres causes.
Les signes cliniques incluent la léthargie, l’anorexie, l’halitose sévère (haleine fétide), la dyspnée (difficulté respiratoire), la pyrexie (fièvre) et la leucocytose (augmentation du nombre de globules blancs dans le sang). La maladie peut progresser rapidement. Le diagnostic est habituellement basé sur des signes cliniques et confirmé par la réponse au traitement, bien que la bronchoscopie et les aspirats à aiguille fine soient utilisés de façon plus intensive pour établir la cause de la maladie pneumonique chez les mammifères marins. Le traitement consiste en une rectification des facteurs environnementaux et en un traitement antibiotique et thérapeutique intensif approprié ».
Le 6 janvier 2017, SeaWorld annonçait que Tilikum, l’orque vedette du documentaire «Blackfish» qui souffrait d’une pneumonie bactérienne résistante aux médicaments, décédait dans sa piscine.
Il succombait ainsi à la cause la plus fréquente de décès chez les cétacés captifs: la pneumonie.
Sur la vidéo publiée par SeaWorld, le vétérinaire rappelle à juste titre que la pneumonie est également une cause de maladie et de décès chez les cétacés sauvages. Mais si les orques libres peuvent parfois mourir de pneumonie, la prévalence massive de cette maladie chez les cétacés captifs pose question. Comment peuvent-ils contracter une telle maladie dans l’environnement hyper protégé et médicalisé des bassins ? Et en mourir ?
Le problème avec Tilikum, comme avec tous les cétacés captifs, c’est qu’ils sont déjà bourrés d’antibiotiques jusqu’à l‘évent depuis l’enfance.
Pour les humains aussi, on le sait, c’est un vrai problème :
« Le danger vient d’une sur-utilisation ou d’un mauvaise utilisation des médicaments antimicrobiens – les antibiotiques étant les principaux – un phénomène observé dans le monde entier » explique un responsable de l’OMS.
Chez les humains comme dans l’agriculture et l’élevage, où les antibiotiques sont souvent massivement utilisés, non seulement pour soigner les animaux mais aussi pour favoriser leur croissance. Les bactéries super-résistantes qui se développent ainsi chez les animaux peuvent se propager chez l’Homme par la contamination de l’eau ou les déjections. Ils peuvent aussi voyager par les exportations de viande. Bien qu’anticipé dès les années 1950 par le découvreur de la pénicilline Alexander Fleming, la résistance antimicrobienne a atteint des niveaux de plus en plus inquiétants ces dernières années, facilitée par l’absence d’antibiotiques nouveaux ».
Notons que c’est aussi d’une pneumonie fulgurante que Keiko est mort.
Tout comme Betty, capturée en Islande en octobre 1978, morte à Antibes le 8 septembre 1987 à l’âge de 13 ans d’une « pneumonie fulgurante» ou comme Kim2 capturé en Islande en 1982, emporté par une « septicémie et une pneumonie fulgurante » le 23 novembre 2005, à l’age de 27 ans, ou comme Léo, mâle, né en 1975, capturé le 23 novembre 1988 au large du Guatemala, mort le 27 janvier 1992 de « pneumonie chronique sévère » au Marineland d’Antibes…
Sharkan et le bacille du pus bleu
Une mort assez commune en bassin est celle causée par le bacille pyocyanique, directement lié aux mauvaises conditions de vie et à la filtration de l’eau des bassins.
L’orque Sharkan, par exemple, bien connue pour avoir engendré Wikie et Inouk, fut capturée en Islande en octobre 1989 à l’âge de 4 ans. Elle mourut le 3 janvier 2009 d’une « septicémie due au bacille pyocyanique» à l’age précoce de 23 ans dans sa prison du Marineland d’Antibes.
Le bacille pyocyanique est connu sous les noms de Pseudomonas aeruginosa, bacille du pus bleu ou pyo.
C’est une bactérie gram-négative du genre Pseudomonas. Elle peut, dans certaines conditions, être pathogène. Très résistante, elle est — avec d’autres bactéries à gram-négatif — de plus en plus souvent responsable d’infections nosocomiales. C’est l’une des bactéries les plus difficiles à traiter cliniquement. Le taux de mortalité atteint 50 % chez les patients vulnérables (immunodéprimés). Germe ubiquitaire, vivant dans les sols et en milieu humide (nuages, robinets, bouchons), très résistant à de nombreux antiseptiques, fréquent en milieu hospitalier, entraînant l’apparition (du fait de sa résistance aux antibiotiques) de véritables souches d’hôpital. Elle peut survivre dans de l’eau distillée ou salée, voire se développer dans certaines solutions antiseptiques ou antibiotiques. Elle fait partie des germes couramment recherchés lorsque l’on procède à une analyse microbiologique d’un échantillon d’eau.
On pense qu’elle se renouvelle dans les hôpitaux via les fruits, plantes et légumes qui y entrent, c’est une des raisons qui explique pourquoi fleurs et plantes vertes sont interdites dans les chambres d’hôpitaux.
Les formes de pathologie qu’elle engendre sont diverses : infection de l’œil, des plaies, des urines, gastro-intestinales et des poumons , des méningites d’inoculation, des septicémies comme stade terminal d’infections graves ou complication chez des malades soumis à un traitement immunodépresseur, des leucémiques, etc.
Elle induit facilement des infections systémiques chez les immunodéprimés, un état très fréquemment induit chez les cétacés captifs pour des raisons psychologiques (deuil, dépression, …)
Beachie et la thrombose du sinus caverneux
La thrombose du sinus caverneux est généralement causée par une infection qui s’est propagée au-delà de la face, des sinus ou des dents. Moins fréquemment, les infections des oreilles ou des yeux peuvent causer une thrombose du sinus caverneux. Pour contenir l’infection, le système immunitaire du corps crée un caillot pour empêcher les bactéries ou autres pathogènes de se propager. Le caillot augmente la pression à l’intérieur du cerveau.
Cette pression peut endommager le cerveau et peut finalement causer la mort. Plus rarement, la thrombose du sinus caverneux peut aussi être causée par un coup sévère infligé à la tête. Ou par une série de coups sévères, comme quand on se frappe la tête contre un mur…
« A Bruges, le dauphin Beachie est mort de façon inattendue.
L’animal venait d’avoir 33 ans. Beachie provient du delphinarium néerlandais de Harderwijk. Il était présent à Bruges depuis 2010 à Bruges dans le cadre d’un programme d’élevage. L’année dernière, il est devenu le père de veaux Moana et Ori ».
« Beachie est décédé suite à l’éclatement d’une veine dans le sinus», a déclaré Gertrude Quaghebeur, responsable de la communication au delphinarium.
« C’est difficile à repérer et vous ne voyez pas venir ce genre d’accident. Nos soignants de l’équipe du delphinarium de Bruges sont très touchés. Mais un dauphin dans la nature vit environ trente ans, en delphinarium, peut être encore plus ».
Ce n’était pas vraiment une surprise, en fait. Le « vieux » dauphin avait déjà subi des examens médicaux durant les mois qui ont précédé son décès – dont un scanner spectaculaire largement relayé par la presse – et ses problèmes de santé était connus depuis deux ans au moins.
Depuis son transfert au delphinarium de Bruges, Beachie se sentait seul et triste. Capturé en Floride, détenu à SeaWorld, il vivait depuis des années dans un lagon d’eau de mer aux Pays Bas en compagnie d’une bande de mâles. Le malheureux s’est retrouvé brusquement isolé dans son coin, en compagnie de femelles dominantes agressives et de juvéniles agressifs, dont son fils Kite, sous le dôme sinistre du Boudewijn Seapark. L’air qu’il y respirait n’était plus le même non plus : le vent iodé du large qui souffle sur Hardewijk fut remplacé par une atmosphère chargée en chlore suffocante sous le dôme sombre du Dolfinarium de Bruges.
Est-ce le chlore qui a causé cette thrombose du sinus ? Ou les coups désespérés que le dauphin se portait à lui-même en se jetant contre un mur ?
Le mystère restera à tout jamais entier.
Terry et la candidose
Outre les infections bactériennes comme la pneumonie, il y a les maladies fongiques, ou champignons, très répandues en bassin. « Les mammifères marins captifs semblent particulièrement exposés aux infections fongiques. La plupart semblent être des effets secondaires du stress, des conditions environnementales ou d’autres maladies infectieuses.
Ainsi, la candidose est une maladie mycosique commune chez les cétacés captifs, générée par le stress, par une désinfection inadéquate de l’eau avec du chlore ou par un usage inconsidéré des antibiotiques. Les lésions se retrouvent généralement autour des orifices corporels.
Lors de l’autopsie, on trouve souvent des ulcères oesophagiens, en particulier dans la région de la jonction gastro-œsophagienne. Un autre champignon opportuniste, le Cryptococcus neoformans, a été diagnostiquée dans la maladie pulmonaire avancée fatale chez un dauphin »
L’orque Unna vient récemment d’en mourir à SeaWorld mais l’exemple le plus terrible d’une mort par champignon est celui de deux dauphins jadis célèbres en Flandres, car vedettes d’une bande dessinée, Terry et Skippy.
La presse de l’époque en parlait ainsi :
« Le delphinarium de Bruges vient d’enregistrer, à dix jours d’intervalle, le décès de deux de ses dauphins adultes. Ceux-ci sont morts respectivement le 1er et le 11 septembre 2000. Skippy avait 10 ans et était né à Boudewijn Seapark. Terry, pour sa part, n’avait que 16 ans.
Le mystère le plus complet entoure pour l’instant ces décès, qui demeurent à ce jour inexpliqués.
« Des autopsies ont été effectuées à l’université de Gand», explique M. Logghe, directeur du parc d’attractions. « Mais elles n’ont rien révélé. On effectue donc maintenant des analyses complémentaires, dont on attend les résultats pour le début de la semaine prochaine. Ce n’est pas la première fois qu’on a des décès, mais c’est rare que cela puisse se produire de façon aussi rapprochée ».
Alors, qu’a-t-il bien pu se passer ?
« Ces dauphins ont arrêté soudainement de se nourrir. Trois jours après, ils étaient morts. On n’a rien pu faire ». Le show a dû être remplacé par un spectacle éducatif, le temps qu’on en sache plus. Evidemment, on imagine que ces morts suspectes vont relancer la controverse sur les delphinariums.
«On ne parle de nous qu’en cas de décès. Mais quand il y a des choses positives à dire, là on n’entend plus nos opposants. Récemment, on a eu six dauphins nés chez nous, dont trois il y a deux ans, qui sont restés en vie ».
Des propos qui choquent les opposants aux delphinariums.
Selon le Dr Gérard Lippert, responsable de l’association belge Delphus, le décès de la femelle Terry (16 ans) serait dû principalement à la présence de levures qui auraient proliféré dans son corps au point de le transformer en «chou-fleur». Skippy était un jeune dauphin mâle âgé de 10 ans. Il était né de Tex et Puck »au delphinarium de Bruges ».
Harley et la chute sur le béton
Les chutes hors des bassins sont plus fréquentes qu’on imagine, soit en tant que gestes de désespoir, soit pendant un exercice. Ainsi, Harley, le plus jeune de tous les dauphins du Zoo du Minnesota, est mort dans l’après-midi du 21 janvier 2006 après avoir sauté hors de sa piscine et s’être brisé le crâne sur la bordure en béton.
Ce bébé dauphin, qui venait de fêter ses sept mois de vie, semble avoir paniqué en nageant entre les deux piscines de soins placées à l’arrière des installations, qui furent pourtant ses seules et uniques demeures depuis sa récente naissance en captivité.
Harley : son nom de baptême avait été choisi au terme d’un vaste concours regroupant plus de 10.000 participants l’an dernier – avait commencé à subir ses premiers dressages. Il s’agissait, dans le cas présent, de rejoindre la piscine ouest à partir de la piscine est, en suivant un canal central, un exercice que détestent les dauphins.
Samedi après-midi, le bébé dauphin, a donc été dirigé, comme on le lui demandait du bassin de maternité à l’est vers le bassin ouest, aux côtés de Rio, sa maman. Tout à coup paniqué, l’enfant s’est jeté contre le mur puis il a sauté en l’air hors du chenal, pour s’écraser enfin sur le sol en béton. Les dresseurs du zoo l’ont aussitôt remis à l’eau mais au bout d’un moment, le petit Harley a cessé de respirer. Des plongeurs descendus dans le bassin ont tenté de l’aider, mais en vain. Un examen médical mené un peu plus tard à l’Université du Minnesota a pu montrer que le bébé dauphin avait souffert d’une grave commotion cérébrale et que ses poumons étaient remplis de sang.
Harley n’avait pas encore participé aux shows mais tous les visiteurs pouvaient le voir, notamment par le biais d’une Webcam installée dans son bassin. Harley était né le 21 juin 2005 au Zoo du Minnesota. C’était le quatrième petit de la femelle Rio, 33 ans, qui a donné naissance à deux mâles en 1992 et 1996, Shadow et DJ, et à une femelle baptisée Spree en 2002. Rio est morte de désespoir peu après.
Pour rappel, quelques dauphins du zoo d’Anvers – dont Dolly, l’amie d’Iris – sont morts de manière semblable. Même pour un dauphin adulte, sauter hors du bassin n’est pas toujours sans risque. Dolly avait du être euthanasiée après s’être brisé la colonne vertébrale lors d’un show un peu trop audacieux. Mais il faut dire que le bassin du Zoo d’Anvers était particulièrement petit.
On lira d’ailleurs à propos d’Anvers l’étonnante variété de pathologies qui décima les 30 dauphins sacrifiés par le zoo.
Mila-Tami et l’ingestion d’objets
«Eclair est mort en février 2015 d’un cancer de la prostate et Mila-Tami en janvier 2015 d’une occlusion gastrique provoquée principalement par des matières végétales. Alizé est toujours là, dans le bassin à spectacles, je viens de lui dire au revoir avant de partir. Quand vous travaillez avec un animal qui vit moins longtemps que vous, forcément, un jour ou l’autre, vous avez à faire à la mort. Nous avons chez nous plus de 3000 animaux, donc il y a des morts tout le temps. Le taux de mortalité chez nous est de 100%, inévitablement. Mais personne ne vous parle des 5 naissances que nous avons eu l’année dernière… ».
Ainsi parlait Jon Kershaw, responsable scientifique au Marineland d’Antibes, après des mois de silence et de rumeurs sur la disparition de ces trois dauphins. Alizé est d’ailleurs mort peu après.
A vrai dire, si un cancer de la prostate survenant chez un dauphin de moins de 20 ans est déjà peu fréquent, l’ingestion de corps étranger qui a tué Mila est un comportement tout à fait spécifique aux delphinariums.
Ainsi que l’indique la littérature scientifique :
« Beaucoup de mammifères marins captifs développent l’habitude d’avaler les objets tombés dans leurs piscines. Chez les cétacés, l’ouverture du deuxième compartiment de l’estomac est faible et des corps étrangers restent bloqués dans le premier compartiment. Souvent, aucun signe clinique n’est visible pendant un temps. évident. À l’occasion, l’anorexie, la régurgitation ou la léthargie peuvent être détectés. Les animaux régurgitent parfois d’eux-mêmes les corps étrangers, mais une aide manuelle est habituellement indiqué. Si rien n’est fait, l’animal meurt ».
Aïcko et la mort mystérieuse des jeunes dauphins captifs
Aucune autopsie pour ce dauphin, pas de diagnostic.
Mais une chose est sûre, les dauphins libres ne meurent pas à 6 ans.
Si le taux de décès à la naissance est aussi important en milieu naturel qu’en bassin (50% de pertes avant un an), les causes n’en sont pas les mêmes : attaque de requin, famine, effets toxiques de la pollution ou parasites pour les dauphins nés en mer.
Mais pour les nés -captifs, l’ennemi, ce sont le retard de croissance staturo-pondérale, la résistance aux antibiotiques du fait d’un surdosage permanent, la chute des défenses immunitaires ou les accidents de bassin.
En liberté, à 6 ans, un dauphin est hors de danger. Il vit alors en bandes avec ses amis, tout en restant proche de ses parents. Sa maturité sexuelle complète ne sera atteinte que vers 10 ans, voire plus tard, mais déjà ses capacités cognitives et culturelles sont arrivées à un point tel qu’il peut faire face par lui-même à de nombreux dangers Son insertion au sein d’un gang – duo, trio, quatuor – lui assure en outre une protection efficace contre les gros costauds plus âgés.
En bassin, en revanche, rien de tel. C’est entre 8 et 15 ans que meurent en masse les nés captifs, tout au contraire de leurs homologues libres, dont l’espérance de vie peut courir alors au-delà de la cinquantaine dans de bonnes conditions.
Livrés à eux-mêmes loin de leur petit clan artificiel, privé du soutien de leur mère ou de leur grande soeur, ils se font rosser parfois jusqu’à la mort ou sont soumis à un stress tel qu’ils se laissent mourir. Peut-être est-ce là la cause de la mort de Aïcko, nous en saurons plus quand l’enquête diligentée par One Voice aura abouti.
Quant aux bébés tués par leur mère lors de combats entre femelles, comme cela s’est passé au parc Astérix et à Planète Sauvage, AUCUNE observation scientifique n’atteste d’un tel comportement en mer.
Tex et le suicide
Certaines personnes nient la capacité des cétacés à se suicider parce qu’ils pensent que les dauphins n’ont un cerveau suffisamment puissant pour cela.
Pourtant, un nombre croissant de scientifiques n’est pas d’accord avec ce point de vue. C’est le cas du Dr Lori Marino.
Dans son article, « Le suicide chez les dauphins: une possibilité ? » le docteur Marino souligne qu’un faisceau de preuves s’accumulent qui indiquent l’existence d’une conscience de soi chez le dauphin, mais aussi d’une capacité à réfléchir à propos de lui-même et des actes qu’il planifie sur le long terme. Ce qui implique clairement qu’il est en mesure de poser des actes intentionnels tels que le suicide.
Outre Kathy, la delphine qui se laissa mourir dans les bras de Ric O’Barry, nous avons de nombreux exemples de suicides réussis. Ainsi, l’orque Hugo se brisera-t-il le crâne contre les murs de son bassin au Miami Seaquarium. Mais la plupart des échouages ou des sorties hors du bassin ressemblent déjà des tentatives de suicide.
Quant à Tex, le mystère reste entier. On sait qu’il s’est brisé la mâchoire quand on l’a déplacé du delphinarium de Bruges au Marineland d’Antibes, on sait aussi que certains disent qu’il se serait brisé le crâne contre les vitres du nouveau lagon et que son amie Aurore serait morte très peu de temps après lui.
Mais nous ne saurons la vérité que le jour où l’un ou l’autre ex-dresseur à la retraite aura assez de courage pour témoigner des faits.
Splash et les ulcères gastriques

Cailloux découverts dans l’estomac de l’orque Nami
Les ulcères gastro-intestinaux constituent un problème important chez les mammifères marins captifs, même si on les retrouve également chez certains animaux en liberté. Les ulcères dans le premier compartiment de l’estomac des cétacés sont courants et posent des problèmes cliniques moins graves que les ulcères de la région pylorique ou du duodénum proximal.
Diverses causes, comme la teneur excessive en histamine du poisson gelé, peuvent être impliquées dans le déclenchement d’un ulcère gastro-intestinal, mais la maladie chez les cétacés captifs doit être considérée comme essentiellement associée à des conditions environnementales ou liées au stress. Les changements environnementaux dramatiques, y compris les changements de personnel ou de compagnons de bassin, peuvent déclencher une ulcération grave de l’ulcère gastro-intestinal chez les cétacés ou les pinnipèdes.
Souvent, l’ingestion d’objets étrangers et les ulcères se combinent.
Le cas de Splash est à cet égard exemplaire : cette orque captive avalait du sable.
Pendant plusieurs années, d’après Hargrove, Splash a ingurgité le sable de filtration qui se retrouvait dans le bassin de l’animal.
« Splash s’ennuyait tellement, l’environnement était si stérile qu’il restait là à ne rien faire pendant des heures — il allait de temps en temps à la surface pour respirer, puis replongeait pour avaler du sable », rapporte Hargrove. Ce type de comportement destructeur chronique a uniquement été observé chez les orques captives, d’après les experts, jamais dans la nature.
«Splash a mangé du sable pendant des années », selon Hargrove. « Le sable de filtration est très rugueux et très abrasif ».
Après la mort de Splash, un vétérinaire de Sea World aurait dit à Hargrove que l’autopsie de l’orque a révélé la présence de «dizaines de kilos de sable dans son estomac» et ce n’est pas ce qui l’a tué, « mais ça ne l’a pas aidé ».
Splash a-t-il avalé suffisamment de sable pour se tuer ?
Le seul rapport officiel disponible au public, le Marine Mammal Inventory Reports, qui répertorie les mammifères marins en captivité, démontre que la mort de Splash est due à un « ulcère gastrique sévère avec perforation de l’estomac ayant entraîné une péritonite ». Selon Naomi Rose, cela signifie que « Splash souffrait de multiples ulcères qui ont gravement endommagé son estomac et a fini par se perforer ».
Elle déclare ne pouvoir seulement faire des suppositions quant au rôle du sable dans la mort de Splash. «S’il avait beaucoup de sable dans l’estomac, déjà fragilisé par les ulcères, cela ne l’a surement pas aidé. Je ne peux pas affirmer que c’est bien le sable qui a perforé son estomac, mais si ce n’est pas le cas, il a probablement empiré son cas en l’avalant».

On peut mourir encore de tant de choses au delphinarium ! Ici, le dauphin Shadow, décédé d’une overdose à l’ecstasy a Connyland en Suisse.
Iris et les maladies fantaisistes
Lorsque la delphine Iris est décédée dans son petit bassin du Zoo de Duisburg, le 28 mars 2003, épuisé par deux décennies de captivité, le vétérinaire Manuel Hartmann a déclaré alors qu’elle souffrait d’une « forme rare de leucémie liée à l’âge ».
Cette affection aurait expliqué l’apathie complète d’Iris durant ces dernières années.
Un traitement spécial aurait permis de la garder en vie un certain temps mais depuis le mois de février, Iris avait de plus en plus de difficulté à maintenir son évent au-dessus de l’eau et à garder une position stable. Lors d’une examen médical sophistiqué (scanner) auquel cette malheureuse a été soumise, il est apparu qu’elle souffrait d’un collapsus pulmonaire partiel.
Le problème, c’est que la « leucémie due à l’âge », ça n’existe pas.
En revanche, les causes psychologiques constituent une explication un peu plus convaincante à sa dégradation physique et mentale . Elle venait de perdre une fois encore un bébé, sans doute conçu par son propre fils, et ne supportait plus de se retrouver confinée dans ce petit bassin latéral, parmi une foule d’inconnus.
De leur côté, les orques Freya et Valentin sont morts coup sur coup à quelques mois de distance.
Freya était la mère de Valentin. Malade depuis toujours, elle aurait succombé, dit le Marineland d’Antibes, à un « arrêt cardiaque ».
Sans doute. Le coeur s’arrête en effet quand on meurt. Mais de quoi ?
Quant à Valentin, sa « torsion de l’intestin » est une affection typique des chiens et des chevaux stressés. Et des dauphins captifs aussi, apparemment, mais pourquoi ?
Stressé par quoi ? L’inondation fracassante des bassins ? La mort de sa mère Freya ? Mais vous n’y pensez pas !
Quand on meurt au delphinarium, ce sera TOUJOURS pour des causes physiologiques, même si parfois il faut les inventer !