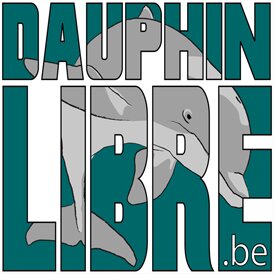La vie en enfer de Jérôme a été racontée par la soigneuse Rachel Weiss qui l’accompagna jusqu’à l’euthanasie
L’histoire de Jerôme le chimpanzé : une vie en enfer
Jérôme est né le 23 février 1982. Il a été retiré des bras de sa mère quand il était bébé. A l’âge de deux ans, on l’a été infecté expérimentalement avec le virus du VIH.
Malgré cela, Jérôme a survécu jusqu’à l’âge de 14 ans au Centre national de recherche sur les primates de Yerkes, un laboratoire financé par le gouvernement fédéral à Atlanta, en Géorgie. On l’avait enfermé dans le bâtiment CID (Chimpanzee Infectious Disease), qui est séparé des autres unités de recherche et des habitation sur le campus principal de Yerkes.
Rachel Weiss, qui s’est chargé de Jérôme à la fin de sa vie, décrit le building CID de l’époque comme une grande boîte en ciment sans fenêtre et ni accès extérieur. A l’intérieur, les chimpanzés occupait des cages dans un espace sombre aux sols et murs humides où quelques rares humains passaient vêtus de combinaisons, de bottes, de masques faciaux et de gants. Même si quelques modifications mineures ont été apportées depuis 2001 à ces installations, certains chimpanzés infectés par le VIH y sont toujours confinés.
Rachel a décrit Jérôme comme étant maigre, timide et chatouilleux. Elle a dit qu’il souriait mais que lorsqu’il a ri la première fois, il s’est mordu un doigt ».
Si nous pouvons nous souvenir de lui aujourd’hui, c’est grâce à Rachel Weiss, qui s’occupa de Jérôme lors de ses derniers mois et l’a accompagné lors de son euthanasie en 1996.
Rachel s’est penchée sur Jérôme lié à sa civière et l’a embrassé une dernière fois, avant de le regarder partir vers la salle d’autopsie recouvert d’un drap blanc, ce qui, selon les normes de laboratoire, peut être considéré comme un traitement royal.
En partageant son histoire, Rachel nous fait voir une réalité toujours présente.
En 2018, des chimpanzés sont encore utilisés par la recherche dans le monde.

Jerôme le chimpanzé : une vie en enfer
En 2003, Jérôme aurait eu vingt et un ans.
Et s’il avait vécu la vie de ses ancêtres, il serait en train de se déplacer librement dans la forêt humide, décidant lui-même en toute connaissance de cause de ce qu’il allait faire de sa journée : observer la savane depuis le sommet d’un figuier, chasser les petits colobes en sautant de branches en branches sur les flots verdoyants de la canopée ou marcher d’un même pas aux côtés d’un ami d’enfance à travers les broussailles…
Jérôme serait devenu aujourd’hui un magnifique chimpanzé mâle adulte, dont le regard farouche, les 130 livres de muscles et d’os, le pelage épais d’un noir d’encre et la force prodigieuse auraient certainement fait craquer toutes les guenons de sa tribu. A lui seul, il se serait fait un plaisir de repeupler la forêt pluvieuse et d’assurer le futur de son peuple.
Mais Jérôme n’a jamais connu ce genre de vie.
Il fut tout au contraire « fabriqué » à l’usage exclusifs des humains, ces êtres qui sans répit, poursuivent leur rêve fou de ne plus être jamais malades. Bien que dotés, comme l’homme, d’intelligence et capables d’émettre des opinions, de faire des choix et de comprendre, les chimpanzés ne sont jamais consultés avant qu’on ne leur vole leurs vies au service de la recherche biomédicale.
Jérôme, pour sa part, a réussi à survivre près de quatorze années dans les geôles du sinistre Centre de recherches primatologiques de Yerkes, un institut situé à Atlanta (Géorgie) et que finance le Gouvernement fédéral des Etats Unis.

Une vie en enfer : l’histoire de Jerôme le chimpanzé
Lorsqu’il n’était encore qu’un bébé, Jérôme fut enlevé à sa maman puis élevé comme un orphelin.
On décida de l’infecter avec le virus HIV lorsqu’il eut atteint l’âge de deux ans.
Onze ans plus tard, quand je l’ai rencontré en tant que soigneuse animalière, il était seul, en train de mourir.
Au lieu d’afficher un beau pelage noir et un regard farouche, Jérôme était maigre et décharné. Son pelage était sec et mat, son visage blême, ses yeux éteints par la peur et la fièvre. Il craignait toute approche humaine, sa personnalité était réduite à néant.
Il avait enduré tout ce que peut endurer un singe encagé, jusqu’à en mourir.
Pour les gens qui l’avaient enfermé de cette manière, sa seule valeur était son sang et le nombre de globules blancs qu’on pouvait y compter. Pour moi, tout ce qui concernait Jérôme avait de la valeur.
Si Jérôme vivait encore aujourd’hui, il est probable qu’il serait toujours seul, à jamais incapable d’entrer en contact avec d’autres chimpanzés. S’il avait eu 20 ans aujourd’hui, il aurait passé l’essentiel de son existence, jour après jour, à l’intérieur de sa cellule, sans jamais avoir ressenti la sensation du vent frais soulevant son pelage ou celle du soleil réchauffant son visage.
Durant dix-huit ans, Jérôme n’aurait connu que la vie dans une cellule de béton humide.
Ses seuls divertissements lui auraient été fournis périodiquement par un humain quand celui-ci y aurait pensé, sous forme d’un petit jouet en plastique, d’une boîte en carton ou d’un journal à déchirer ou peut-être même, quelquefois, d’un dessin animé à la télévision.
Il aurait passé les dix-huit dernières années de sa vie à ne manger que ce que les humains auraient décidé qu’il mangerait, et seulement quand ils le décideraient, peu importe ce qu’il voulait ou non, peu importe ce qu’il aimait ou non, peu importe s’il avait faim ou pas.
Mais ce n’est pas ainsi que cela s’est passé :
Les symptômes du sida on été diagnostiqués chez Jérôme en septembre 1995.
Aussitôt, il fut séparé de ses deux compagnons de cellule et enfermé tout seul jusqu’à sa mort.
Durant ces six derniers mois, Jérôme n’a plus eu l’occasion de jouer ou de toucher un autre chimpanzé. La pneumonie, la diarrhée chronique et l’anémie ont achevé de l’épuiser. Jérôme a été euthanasié par des chercheurs quelques jours avant son 14eme anniversaire.
Une fois au fond de sa petite cellule de béton et d’acier, Jérôme a manifesté tous les signes de la pire frustration, de l’incompréhension la plus totale et de la peur. Le plus souvent, il se tenait serré contre les barreaux de sa cage, à regarder de loin les autres chimpanzés, ses pouces enfoncés dans les oreilles et son visage déformé par l’expression du plus grand désespoir.
Les modifications que subissaient son propre corps le déconcertaient complètement : il enfonçait son doigt d’un air intrigué dans son ventre affreusement distendu et gonflé, il observait dans un petit miroir sa langue devenue grise à cause de l’anémie.
Il avait peur de tout, même des choses les plus habituelles.
Ainsi, il se réfugiait dans le fond de sa cage lorsque j’enlevais la manche de caoutchouc de ma combinaison pour lui donner la main à travers les barreaux, comme nous le faisions pourtant auparavant.
Plus d’une fois, je l’ai vu sangloter dans son coin en silence ou se cacher dans un recoin pour tenter d’échapper aux fléchettes du revolver à sédatifs.
Jérôme est mort le 13 février 1996, et plus personne ne devrait à l’avenir endurer de tels traitements ni vivre de telles conditions de vie, pourtant considérées par les chercheurs et le législateur comme étant « humaines » puisque codifiées par la Loi sur le Bien-être animal (Animal Welfare Act) malgré leur caractère barbare et cruel.
Dans son malheur, Jérôme a eu de la chance, car des dizaines d’autres « sujets de recherches », ses compagnons de misère, continuent à subir cette existence carcérale chaque jour de chaque année, au Centre de Yerkes.

Deux d’entre eux – Buster et Nathan – sont gardés en isolement dans le même genre de cellule vide que celle où a vécu Jérôme et s’y trouvent depuis des années.
Des années !
Imaginez cela : des jours, des semaines, des mois, des années, des siècles à l’échelle de la pensée de ces singes, sans avoir le moindre contact avec qui que ce soit, si ce n’est un laborantin masqué vêtu d’une combinaison étanche en latex qui surgit de temps en temps. Certains autres chimpanzés partagent à deux ou à trois leurs cellules étroites, mais eux aussi souffrent des conditions de vie liées à l’emprisonnement et à la restriction sensorielle.
Buster et Nate sont déjà un peu plus âgés que Jérôme ne le serait aujourd’hui.
Les raisons de leur isolement sont inconnues.
Ni l’un ni l’autre n’ont développé les symptômes cliniques du SIDA, et ce n’est donc pas pour des raisons sanitaires qu’ils sont ainsi isolés. Peut-être est-ce tout simplement trop compliqué pour Yerkes que de leur offrir l’environnement social dont ils ont un si urgent besoin.
Depuis vingt ans que des chimpanzés sont employés en tant que sujets biomédicaux pour des recherches sur le SIDA, aucun médicament, aucun vaccin n’a encore été découvert ou créé grâce à ces études menées sur des chimpanzés vivants.

Les enclos extérieurs ds chimpanzés au Yale Laboratories of Comparative Psychobiology dirigé en 1932 par Robert M. Yerkes.
À l’exception (possible) de Jérôme, les chimpanzés ne développent pas le SIDA.
Le virus agit de manière très différente sur leur système immunitaire que sur celui des humains. Dès lors, si vous ne vous souciez pas des chimpanzés, considérez au moins les sommes d’argent gaspillé pour eux – un argent qui pourrait être dépenser pour aider vraiment les humains.
Des millions de dollars sont dilapidés chaque année pour leur seul entretien, sans parler du temps, des compétences et de l’énergie perdue. Des associations médicales se sont d’ores et déjà élevées contre les conditions de vie inhumaine imposées aux singes de laboratoire, mais la recherche biomédicale continue à fonctionner sur des bases fallacieuses.
Ceci ne concerne pas seulement les recherches menées sur les chimpanzés, mais aussi les dizaines de milliers de singes, de chiens, de lapins et d’autres non-humains embarqués de force dans ce type d’investigations scientifiques hasardeuses. Les avancées technologiques, combinées avec les recherches épidémiologiques et aux études cliniques menées sur des humains ont amené à des résultats bien plus intéressants au niveau scientifique et directement applicable aux patients.
Rien qu’aux Etats-Unis, pas moins de 200 chimpanzés inoculés au SIDA se languissent actuellement dans des cellules de « biocontention » – certaines sont vastes, d’autres minuscules, toutes constituent un milieu de vie artificiel et contraignant.
1500 chimpanzés supplémentaires ou plus encore sont utilisés pour étudier la goutte, l’hépatite, la malaria, les troubles de la reproduction, et d’autres déficiences humaines, même les plus rares, devraient tout de même pouvoir bénéficier d’un peu plus d’espace et d’air frais.
Mais ils vivent des vies totalement aberrantes dans ces laboratoires américains aussi bien qu’en Europe et ailleurs dans le monde. Chacun d’entre ces chimpanzés possède portant un nom, un visage, une véritable personnalité.
Chacun d’entre eux a pourtant été asservi parce que les humains estiment encore et toujours que cette injustice est justifiée au nom de leur race supposée supérieure.
Une loi connue sous le nom de CHIMP (Chimpanzee Health Improvement, Maintenance and Protection) a été décrétée aux USA. Elle est sensée fournir des solutions de rechange à l’enfermement de singes en laboratoire, mais également pour améliorer l’existence future de certains de ces individus en les retirant des laboratoires et en les plaçant dans des lieux mieux adaptés, en compagnie d’autres singes.
Mais cette Loi CHIMP ne va pas assez loin. Pour remédier à ces souffrances, toute recherche sur les chimpanzés doit prendre fin et la reproduction forcée en captivité arrêtée pour toujours.

Les morts récentes des chimpanzés Pablo et Annie, deux résidents aimés par toute l’équipe du sanctuaire pour chimpanzés « Fauna Fondation », le seul existant à ce jour au Canada, nous démontrent qu’il n’est pas suffisant de se contenter de retirer ces singes hors des laboratoires au terme d’une certaine période.
Pablo et Annie n’étaient pas vieux et pourtant, les quatre années de soins, d’amour et de respect sans conditions qui leur ont été données au centre n’ont pas suffi à effacer les dommages causés par les décennies qu’ils passèrent en laboratoire au service de la soi-disant « recherche ».
Lors de leur autopsie, on constata en effet des adhérences massives attachant leurs organes ensemble, sans doute causées par l’usage de fléchettes, la méthode préférée de laboratoire de donner des sédatifs à un chimpanzé à distance et ceci pendant des années. Ni l’amour que nous leur avons donné par la suite, ni l’espace, ni la vie sociale n’ont pu soigner ces traumatismes.
Le fait d’accorder aux chimpanzés de laboratoire des cellules plus grandes avec un accès vers l’extérieur, une vie sociale plus riche, le choix de leur nourriture ou des méthodes alternatives aux fléchettes sédatives constitue une étape, sans doute, mais ce n’est pas assez et ce n’est pas ce qu’ils méritent.
Les grands singes méritent le respect, ils méritent de ne pas vivre au service aux humains.
L’une des choses qu’ils ne pourront jamais avoir en captivité est la totale liberté de choix, qui définit le statut des gens libres.
Car les chimpanzés sont des gens – pas des humains, mais des gens – et nous leur rendons, à eux aussi bien qu’à nous-mêmes, un bien mauvais service en les traitant comme s’ils étaient nés pour nous servir et pour ne pas vivre dignement l’existence pour laquelle ils sont nés.
Même si la recherche humaine les réclame, leurs vies n’appartiennent à personne d’autre qu’à eux-mêmes et ce dont ils ont besoin plus que de toute autre chose est d’être traité en conséquence.

La recherche scientifique en a déjà détruit beaucoup trop cette année (2002), et tous sont morts à un âge largement inférieur à leur espérance de vie normale qui est d’environ 50 ans.
Manuel: détenu à Yerkes, inoculé au HIV, fut un moment le compagnon de cellule de Jérôme. Mort pour cause inconnue à l’âge de 22 ans, le 17 avril 2002.
Sonia: détenue à Yerkes, morte d’un disfonctionnement organique dans une toute petite cage loin de sa famille, le 5 juin 2001, à 42 ans.
Gina: détenue au Coulston Foundation (un laboratoire du Nouveau Mexique) morte d’avoir été brusquement exposée au soleil et à la chaleur lors de sa première sortie à l’air libre en 2001 à l’âge de 12 ans.
Sellers: détenu à Yerkès. Mort étranglé accidentellement en juin 2001 lors d’une recherche sur la goutte alors qu’il était seul et sans surveillance dans une cage minuscule. Age : 18 ans..
Pablo : recueilli à la Fauna Foundation, il meurt d’un excès de tissu cicatriciel et d’une mauvaise santé générale le 6 octobre 2001, à l’âge de 31 ans.
Annie : résidente et matriarche à la Fauna Foundation , morte d’une gangrène de l’intestin et d’un état de faiblesse générale le 10 janvier 2002 à l’âge de 42 ans.
Koen : détenu au BPRC, un laboratoire hollandais, inoculé au HIV+, mort pour une cause inconnue le 29 janvier 2002, à 28 ans…
Ce sont là juste quelques individus parmi d’autres, qui ont eu la chance d’avoir des amis humains pour raconter leur histoire. Sans doute, beaucoup d’autres meurent-ils ailleurs sans que l’on en sache rien.
En mémoire de tous ceux -là et en pensant aussi avec douleur aux deux bébés qui ont été récemment arrachés à leurs mères au laboratoire de Coulston pour être revendus à l’industrie du divertissement afin que nous puissions rire en les voyant lors de spots publicitaires à la télévision et au nom des autres chimpanzés toujours détenus à Yerkes dans le cadre de recherches sur le Sida – Buster, Nathan, Arctica, Joye, Betsie, Jonah, Marc, Roberta, Tika et Hallie – je vous demande de vous souvenir d’eux.
De vous souvenir de Jérôme, qui naquit et vécut en enfer dans une cellule solitaire…
Une vie en enfer
Un article de Rachel Weiss (2001) adapté en français par Y.G

Expérience sur le « contrôle de l’esprit » en 1971
De 2001 à 2018
Aux États-Unis, le United States Fish and Wildlife Service a reclassifié en septembre 2015 tous les chimpanzés comme étant membres d’une espèce en danger, y compris ceux déjà détenus en captivité aux États-Unis. Cela rend illégale la conduite de recherches invasives sur les chimpanzés sans permis, mettant ainsi fin à leur utilisation en tant que sujets de recherche médicale. Il reste cependant encore beaucoup à faire pour transférer les chimpanzés entreposés dans les laboratoires de recherche dvers des sanctuaires agréés.
En novembre 2015, le National Institutes of Health annonçait un plan de retrait pour tous les chimpanzés relevant de sa direction et leur transfert vers des sanctuaires accrédités.
Bien que les chimpanzés vivant dans des laboratoires privés attendent toujours leur retraite, il est devenu plus difficile de justifier juridiquement leur utilisation dans des recherches invasives. Save the Chimps espère que tous les laboratoires américains rejoindront les NIH et annonceront le départ à la retraite des chimpanzés sous leur responsabilité.
Les grands singes en Europe
L’Union Européenne continue elle aussi à mener d’abominables expériences sur ces hominiens supérieurement intelligents et sensibles, enfermés à vie dans un laboratoire obscur et surpeuplé des Pays-Bas.
Le Biomedical Primate Research Centre (BPRC) situé à Rijswijk, non loin de La Haye (Pays Bas) est le plus grand laboratoire de recherches utilisant des primates en Europe.
Derrière ses hauts murs, ses portes verrouillées, ses clôtures barbelées, plus de 1500 primates survivent dans des conditions que le Gouvernement néerlandais a reconnu comme « ne rencontrant pas les standards d’accueil généralement admis ».
Les experts en bien-être animal qui ont visité ces installations estiment qu’il s’agit là d’un euphémisme !
Plus de 500 macaques sont maintenus dans des cages individuelles si petites qu’ils ne peuvent même pas étendre leurs membres. Les guenons sont utilisées comme des machines à enfanter, leur bébé leur étant retiré sitôt après l’accouchement en vue d’atroces manipulations.
La Belgique a renoncé aux expériences sur les grands singes en 2009.
« En Belgique, le conseil des ministres a adopté, le 24 avril, deux textes visant à mieux protéger les animaux utilisés en expérimentation. Il est désormais quasiment interdit d »utiliser des primates anthropoïdes en expérimentation animale. Ceci concerne les gorilles, les chimpanzés, les bonobos et les orangs-outangs. Reconnaissant les capacités comportementales et émotionnelles de ces animaux, les ministres les ont exclus de l’expérimentation animale. Des exceptions demeurent toutefois possibles, par exemple lorsqu »une expérience sur un grand singe est indispensable au profit de la santé humaine »
…mais pas sur les autres primates !
L’Université catholique de Louvain-la-Neuve torture toujours gaiement des babouins capturés en Afrique ou des macaques venus de l’île Maurice, de Chine, du Cambodge , du Népal ou d’ailleurs !

Raymar, sujet d’étude mais pas de droit
Un site en hommage à Jérôme
Chimps in Laboratories
NIH Releases Plan to Retire All Government-Owned Chimpanzees
Despite efforts to thwart the process, NIH says it will retire chimpanzees to sanctuary