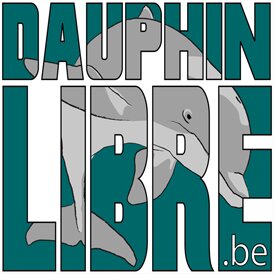Les mystérieuses cultures des orques de l’Antarctique
RECHERCHES
Deux des plus grands experts mondiaux de l’orque, ce prédateur le plus haut placé sur la chaîne alimentaire après l’homme, se trouvaient récemment en Antarctique, en train de procéder au marquage d’une créature dont le remarquable comportement de chasse coopérative et la transmission de savoirs intergénérationnels ne rivalisent qu’avec les capacités humaines en ce domaine.
L’après-midi du 10 janvier 2012, à la pointe de la péninsule Antarctique, les chercheurs Robert L. Pitman et John W. Durban se tenaient sur le pont d’un navire de croisière, cherchant à découvrir à la jumelle la présence d’épaulards. La mer de Weddell, où les corps de l’explorateur anglais Ernest Shackleton et de ses hommes restèrent enterrés dans la glace pendant près d’un siècle, était calme et parsemée d’icebergs. Il pleuvait, ce jour-là, un phénomène de plus en plus fréquents en été dans cette partie de l’Antarctique qui se réchauffe rapidement.
Vers 3 heures de l’après-midi, Pitman repéra des ailerons triangulaires émergeant des vagues à quelque 2 miles de distance. Bientôt, près de 40 orques surgirent de tous côtés autour du bateau nommé le «National Geographic Explorer », suscitant l’émerveillement des 150 passagers à bord.
Pitman et Durban sautèrent dans un Zodiac en caoutchouc conduit par un biologiste de l’équipage et naviguèrent lentement en direction des cétacés. Deux grandes orques femelles s’approchèrent, roulèrent sur le côté et, se souvient Pitman, « nous regardèrent longuement, les yeux grands ouverts, tandis qu’elles passaient à quelques mètres sous le Zodiac ».
L’une des femelles fit surface à côté du canot. Durban, à l’aide d’une arbalète, projeta un émetteur satellite au milieu de son aileron dorsal. Lorsque la deuxième orque remonta à son tour, une seconde flèche fut tirée, afin de prélever un échantillon de tissu à des fins d’analyse scientifique.
C’est ainsi que commença plus d’un mois de recherche sur les orques de l’Antarctique, menée par les deux des plus grands experts mondiaux dans ce domaine. « La puissance de ces grands prédateurs, a dit Pitman « n’a probablement jamais été concurrencée depuis que les dinosaures ont quitté cette planète il y a la terre 65 millions d’années».
Près de 50.000 orques parcourent les océans du monde aujourd’hui, et la moitié d’entre eux vivent sans doute dans les eaux de l’Antarctique. Cependant, bien que les orques soient les créatures les plus facilement identifiables de l’univers marin, pas mal de choses les concernant demeurent mystérieuses, en particulier au nord de la planète. Pitman et Durban tentent aujourd’hui de recueillir des informations des renseignements de base concernant leur comportement et leurs habitudes alimentaires.
Ces données de base sont particulièrement importantes à l’heure où le changement climatique et d’autres impacts anthropiques, tels que la surpêche et l’accumulation de produits chimiques dans l’océan, sont en train de modifier les habitats des cétacés et ceux de leurs proies.

Le réchauffement climatique peut dérégler les saisons des glaces, mais les orques s’adaptent vite. Ici, elles respirent dans une mer de glaces fondante
Les scientifiques du monde entier en sont toujours à discuter de la façon dont il convient de classer les nombreuses espèces et sous-espèces d’orques vivant en Alaska, dans le Nord-Ouest du Pacifique au large des États-Unis et du Canada ainsi que dans l’Atlantique Nord.
En Antarctique, Pitman et Durban – qui travaillent pour le compte de la US National Marine Fisheries Service à La Jolla, Californie – ont joué un rôle majeur dans l’identification des trois principaux types d’orques présentes dans cette région ainsi que celle d’un quatrième type, habitant la région sub-antarctique.
Ces populations – probablement des espèces distinctes – diffèrent par les motifs noirs, blancs et gris qui ornent leur peau. Elles se distinguent aussi par la forme de leurs nageoires dorsales et le profil de leur tête, tout autant que par les zones géographiques où elles se repartissent et par le choix de leur nourriture ou leurs habitudes de chasse.
Chaque individu porte en outre des marques spécifiques sur la selle, juste derrière l’aileron. Pitman et Durban ont recueilli à cet égard une collection de 40.000 photos de « baleines tueuses », à tel point qu’ils peuvent aujourd’hui reconnaître sans se tromper tous les individus au sein de leurs familles élargies. Mais ce qui a conduit ces deux hommes à poursuivre leurs recherches n’est pas tant l’envie de les classer ou de connaître leur routes migratoires que celle de mieux saisir l’extraordinaire culture et les coutumes de ces cétacés, dont les techniques de chasse coopérative et la transmission de connaissances ne se retrouvent que chez les humains.

Orques de l’Est de l’Islande. Un tout autre peuple.
SOCIETE ORQUE
Les orques (Orcinus orca) vivent longtemps, très longtemps : nombre de leurs femelles atteignent ou dépassent les 90 années d’âge. Ces grands prédateurs se déplacent en groupes familiaux élargis. Les enfants demeurent généralement leur vie entière auprès de leur mère. Des groupes stables se rassemblent ensuite en unités plus vastes composées de lignées maternelles différentes (une matriarche et sa progéniture).
La société orque est basée sur une première unité matrilinéaire constituée de la matriarche, de ses enfants et de ses petits-enfants, c’est-à-dire a minimum de 5 à 6 individus. Du fait que les femelles peuvent atteindre 90 ans en liberté, il n’est pas rare de voir 4 générations qui se déplacent ensemble. Ces groupes matrilinéaires sont très stables. Ses membres ne se séparent que quelques heures par jour, pour aller s’accoupler ailleurs ou se nourrir.
A un deuxième degré, de 2 à 4 unités matrilinéaires se regroupent pour former un pod, composé d’une vingtaine de personnes.
Ces pods peuvent se diviser et se séparer durant plusieurs semaines avant de se retrouver.
Le troisième niveau de la structure sociale des orques est le clan.
Il regroupe un ensemble de pods, qui partagent tout à la fois le même dialecte semblable et une lointaine ancêtre commune.
Le dernier stade de l’organisation des orques est appelé une « communauté ». Il s’agit d’un vaste ensemble de clans qui socialisent et se retrouvent régulièrement, mais ne partage ni le même dialecte ni d’ancêtres communs. Les groupes de troisième degré communiquent donc entre eux à l’aide d’un dialecte particulier de type « globish » ou esperanto, utilisant un ensemble varié de clics, de sifflements et de sons pulsés. On pense que les épaulards – dont la grossesse dure 17 mois – reconnaissent et apprennent les appels de leur mère «in utero» et qu’ils naissent dès lors avec la capacité immédiate de communiquer.
Jusqu’à 4 générations d’épaulards peuvent voyager ensemble, qui font usage de techniques étonnamment sophistiquées de chasse en groupe transmises d’une génération à l’autre.
« Vous avez là des individus qui passent 50, 60, 80 ans de leur vie ensemble. Vous pouvez réaliser tout un tas de choses quand vous passez autant de temps avec votre famille et des personnes qui lui sont associées », déclare Pitman, « Vous pouvez chasser de manière coopérative. Vous pouvez consentir à des sacrifices que d’autres animaux n’accepteraient pas. Si vous tuez 50.000 phoques dans votre vie, vous êtes plutôt doué dans ce domaine. Et si vous apprenez quelque chose, vous l’enseignez à votre progéniture. Ce type de vie sociale les rend tout à fait remarquables et très humains dans les actes qu’ils posent. Nous avons des grands-mères, grands-mères et arrière-grands-mères, qui voyagent en groupe avec des jeune et leur transmettent leurs connaissances culturelles», ajoute Durban.
Il y a trois ans, plus au sud, le long de la péninsule Antarctique occidentale, Pitman et Durban ont passé trois semaines à observer ce comportement d’un pod « d’orques des glaces », que l’on nomme aussi les épaulards de type B Antarctique . Ils ont étudié une technique de chasse dite «lavage de vague ». Un groupe de cétacés glisse à travers la banquise, tandis que ses membres
élèvent la tête hors de l’eau- un comportement connu sous le nom « spy-hopping » – à la recherche de leur repas préféré : les phoques de Weddell, bien gras et piscivores.
Une fois qu’ils en ont repéré un sur un ilôt de glace flottante, d’autres orques sont appelées en renfort. Puis à 2 à 7 nageant de front, ils foncent sur la banquise et balaie le phoque à bas de son refuge en créant une grande vague à puissants coups de caudale.
Pitman et Durban ont observé alors ce qu’ils appellent le «massacre» des phoques. Les cétacés noyaient d’abord leurs proies, avant de les éplucher méticuleusement pour accéder à leur chair de choix. « C’était choquant de voir ça », dit Pitman. « Vous n’êtes pas habitué à voir des animaux se comporter de manière aussi futée! »
PEUPLES ET TRIBUS
Les deux chercheurs rencontrèrent aussi 40 épaulards dans la mer de Weddell, probablement issus de 3 lignées maternelles appartenant à un «écotype» – ou peut-être même à une nouvelle espèce – de l’Orque de Antarctique nommée Petit type B.
Ce groupe ethnique est lié à celui des grands chasseurs «à la vague» de Grand type B. Mais l’on en sait fort peu sur le Petit type B.
Pitman et Durban les ont parfois vu s’alimenter sur les pingouins Gentoo et Shinstrap mais jamais sur les phoques. Le but des chercheurs est d’obtenir une meilleure connaissance de ce que le Petit type B mange.
La taille des individus est à peu près moitié de la masse d’un grand épaulard, le type A de l’Antarctique, qui demeure plus au large et chasse les petits rorquals. Les mâles de Type A peuvent atteindre plus de 9 mètres de long et peser jusqu’à 10 tonnes.
Trois semaines après avoir été équipée d’une balise, l’épaulard femelle et son pod ont parcouru des centaines de kilomètres en Mer de Weddell, en contournant parfois la banquise. Durban et Pitman ont réussi à tagger 15 orques de l’Antarctique avec des émetteurs satellites de 39 grammes au cours des trois dernières années. Les résultats ont considérablement élargi les connaissances de leurs habitudes, de leurs habitats préférés et de leurs migrations.
Six des orques de type B ont opéré des voyages rapides, suivant une trajectoire nord presque identiques, passé les îles Falkland et au-delà de l’océan Atlantique au large du Brésil. L’une d’elle a fait un aller-retour de 9.656 km, de l’Antarctique jusqu’au Brésil, en seulement 42 jours.
Durban et Pitman pensent que les baleines se livrent à ces déplacements inconnus jusqu’ici dans un but principal: se débarrasser de leur épiderme et s’en constituer un neuf. C’est une chose qu’ils ne pourraient pas faire dans les eaux glaciales de l’Antarctique, car ils perdraient trop de chaleur.
Quatre jours après que les scientifiques aient marqués cette orque la baleine dans la mer de Weddell, l’Explorer était au large de la péninsule Antarctique occidentale, dans le détroit de Gerlache, un passage d’une beauté époustouflante flanqué des deux côtés par des montagnes glaciaires. Là, les scientifiques ont rencontré de vieux amis – un groupe de la famille élargie de plus ou moins 70 petits orques de type B qui passaient beaucoup de temps dans le détroit.
C’est le genre de travail que des scientifiques dans le monde entier sont en train de faire aujourd’hui, afin d’intensifier la recherche sur ce mammifère marin longtemps considéré comme une espèce unique alors qu’il en existe probablement plusieurs.
Les tests génétiques, par exemple, nous montrent que les » transients », ces épaulards mangeurs de mammifères du Pacifique Nord-Ouest, auraient divergé des «résidents» mangeurs de poissons il y a de cela un demi-million d’années.
Ils devraient sans doute être reconnus comme une espèce distincte, même s’ils résident dans les mêmes eaux. Ce n’est pas une question purement académique car des espèces distinctes, qui se sont adaptées pour vivre dans certaines régions et manger certains proies, peuvent se montrer plus ou moins vulnérables aux changements environnementaux.
Ce changement se produit rapidement.
De nombreux groupes de ces prédateurs ont accumulé des niveaux extrêmement élevés de PCB et autres produits chimiques toxiques, avec des effets potentiellement néfastes sur leur développement et leur reproduction. Le réchauffement climatique est également en train de modifier leur monde et celui de leurs proies.
Tandis que fond la glace de mer de l’Arctique en été, par exemple, quelle sera désormais la relation prédateur-proie entre les orques et les baleines grises dont la migration s’étend plus profondément dans l’océan Arctique ?
Pendant ce temps, dans l’Antarctique, Pitman et Durban continuent à élucider le mystère des épaulards. Récemment, le tag de mesure de profondeur apposé sur une orque dans le détroit de Gerlache a révélé que les épaulards se livraient à des plongées profondes à plusieurs reprises pendant la nuit, descendant jusqu’à 570 mètres au large de la péninsule Antarctique occidentale.
Ce fait indique, pour la première fois, que les orques étaient également capables de chasser le calmar et les poissons sur le plancher marin.
(…)
2/2/2012
Mysteries of Killer Whales Uncovered in the Antarctic
BY FEN MONTAIGNE

Les grandes cultures cétacéennes