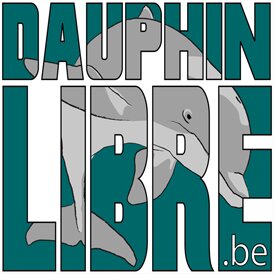Les méthodes de capture des delphinariums
Les méthodes de capture des delphinariums s’apparentent à des rapts d’une extrême violence.
Les jeunes dauphins en sont la cible principale. Mais comment procède-t-on ?
Le filet à seine
Jusqu’en 1989, les dauphins Tursiops de l’Atlantique ont été capturés sans difficulté le long des côtes de Floride et du Golfe du Mexique. Ils peuvent l’être encore aujourd’hui, puisque la US Navy a le droit d’en prélever en mer selon ses besoins.
Les méthodes de capture en eaux peu profondes exigent la présence de deux bateaux hors bords. Le premier est destiné à encercler les cétacés avec un filet à la traîne disposé en demi-cercle (seine net) et l’autre est affecté au transport des captifs.
Un petit avion de repérage est quelquefois utilisé pour localiser préalablement les animaux. Une fois que tout est en place, un second filet, plus petit, est placé à l’intérieur du cercle et tendu sur une distance de 10 à 12 mètres en diamètre, afin de réduire complètement les mouvements des dauphins. Lorsque le piège se referme, les dauphins commencent habituellement à heurter le filet, en s’y empêtrant davantage et augmentant par là le risque de noyade. Les animaux prisonniers des mailles du filet sont sortis les premiers et tirés à bord.
On les mesure, on détermine leur sexe et l’on procède à un bref examen physiologique (Cornell,1986).
Asper (1975) a déclaré à ce propos que les animaux étaient choisi selon certains critères : les plus grands pour la reproduction en bassin, les jeunes de 3 à 5 ans pour le dressage.
Le National Marine Fisheries Service n’ayant jamais jugé utile de contrôler ces opérations, le nombre d’animaux tués à cette occasion reste inconnu. Les prises en eaux territoriales américaines sont censées avoir pris fin avant 1990 mais continuent ailleurs dans le Golfe du Mexique, notamment près de Cuba. Elles se poursuivent à grande échelle au Japon, en Russie et aux Iles Salomon (2012)
Le filet-cerceau
La technique du filet-cerceau détachable est principalement utilisée pour capturer les cétacés de haute mer qui pratiquent le «bow-riding » (nage devant la lame d’étrave d’un navire).
Cette technique a notamment été utilisée pour attraper une baleine grise, de fausses orques ou des bélugas et se pratique encore couramment pour la capture des dauphins bleu et blanc du Pacifique ou les globicéphales.
L’homme chargé de la capture se tient en avant du bateau, sur une avancée de la proue, et s’efforce de positionner le filet lorsque les mammifères font surface pour respirer.
Une mise en place efficace du processus provoquera le détachement du filet, emprisonnant aussitôt l’animal, lequel est d’ores et déjà relié à une bouée et à une corde pour le récupérer. Lorsque le mammifère marin est ramené contre le bateau, un harnais lui est passé sous le corps et permet de le hisser à bord (Cornell 1986).
Lors des premières captures, on utilisait fréquemment le «tail-grabber», une sorte de grue qui extirpait le dauphin hors de l’eau en le tirant par la caudale. Cette méthode, douloureuse et dangereuse pour l’animal, est encore utilisée à l’occasion aujourd’hui.
A propos de la capture et du transport des dauphins à flancs blancs du Pacifique, Ken Ramirez (1991) du Shedd Aquarium déclarait : «Ces dauphins du Pacifique ont la réputation d’être des animaux hyperactifs et très nerveux. Il est extrêmement difficile pour eux de supporter un long transport en état d’immobilité complète ».
Depuis 1963, environ 110 dauphins de ce type ont pourtant été capturés à l’usage des delphinariums américains. 22 d’entre eux étaient encore vivants en 1995. Au moins 76 globicéphales ont été capturés depuis 1957 : deux étaient encore vivants en 1995.
Presque tous les dauphins du Pacifique et les globicéphales concernés ont été capturés dans les eaux californiennes.
Depuis 1967, des bélugas ont commencé à être capturés de manière exclusive par la firme Nanuk Enterprises, de la Baie d’Hudson, selon un protocole de capture particulièrement choquant : les spécialistes de ce mode de capture sont appelés les « cow-boys des mers froides » car ils poursuivent les baleines blanches jusqu’aux eaux de faible fond puis les chevauche et les soumettent comme dans un rodéo avec des chevaux sauvages. C’est ainsi qu’a été capturés l’un des deux bélougas du Zoo de Duisburg, décédé aujourd’hui.
Toutes les captures ont lieu durant l’été, lorsque les grands cétacés blancs se rassemblent dans les estuaires plus chauds afin de s’y nourrir.
Les bélugas capturés sont âgés de 3 à 6 ans , si l’on en juge par leur taille et la couleur de leur peau. Il semble cependant que le parc marin Mystic Marine Life ait acquis un béluga âgé de moins d’un an (Kelly, 1990).
Pas moins de 67 bélugas ont été capturés pour les delphinariums des USA depuis 1961. 29 d’entre eux vivaient encore en avril 1995.

Capture des orques
Les premières captures d’orques ont été menées de manière opportuniste et téméraire : les méthodes incluaient le harpon ( !), les filets-cerceau, les filets à seine, etc.
Les captures pratiquées dans le Nord-ouest du Pacifique supposaient que l’on guette les orques lorsqu’elles nageait dans un petit bras de mer ou une passage étroit , puis que l’on place un filet à la sortie afin de s’emparer de toute la troupe d’un coup. (Hoyt, 1992). Des explosifs telles que les «bombes à phoques» ont été occasionnellement utilisé pour mener les orques vers l’intérieur de baies peu profondes.
Eric Hoyt (1990) a décrit les réactions des orques récemment capturés dans ce genre de filets : « Ces quatre orques captives vocalisaient avec de brusques explosions de sons désespérés. C’était de puissants appels à l’aide. Ils étaient puissants. Sous l’eau, ces cris portaient au moins jusqu’à 7 miles. En surface, dans de bonnes conditions, peut-être à quelques centaines de yards ». Les techniques de captures en eaux profondes supposent qu’un animal ou plus soit encerclé dans un filet à seine en forme de poche (purse seine net).
Asper (1975) suggérait que les sub-adultes des plus grandes espèces (bélugas et orques) soient choisis entre un et cinq ans d’âge. Les premières équipes chargées de ces captures avaient tendance à relâcher les plus gros exemplaires, en ne conservant que des orques d’environ 4,8 mètres et les bébés. Selon Sigurjonsson et Leatherwood (1988), les orques d’Islande sont généralement âgées de deux ans ou même moins au moment de la capture.
Parmi celles que l’on a exportées, 27% mesuraient moins de 3 mètres ! La capture d’animaux aussi jeunes va manifestement à l’encontre des recommandations des spécialistes expérimentés. Selon le vétérinaire pour mammifères marins et ravisseur professionnel de cétacés bien connu, Jay Sweeney (1990)):
« Les tentatives d’enlever un jeune cétacé de moins de deux ans à sa mère provoque très fréquemment un stress intense chez cet animal. Lorsqu’ils sont enlevés avant l’âge de deux ans, les juvéniles, surtout les mâles, ont la plus grande difficulté à affronter l’environnement de la captivité et même toute vie sociale dans un nouveau groupe ».
Depuis 1964, au moins 130 orques ont été capturés à l’usage des delphinariums du monde entier. Des 77 orques qui ont été capturées et importées vers les seuls établissements d’Amérique du Nord, 16 survivaient encore en 1996.

Méthodes sanglantes au Japon
La presque totalité des « fausses orques » (petit cétacé sombre proche du globicéphale) maintenues à ce jour dans les aquariums américains ont été acquises au Japon, soit directement à la suite des pêches sanglantes menées sur les îles Taiji et Iki soit par l’intermédiaire des delphinariums japonais qui se fournissent eux-mêmes auprès des pêcheurs.
Le président du Marine World, Michael Demetrious (1993) a officiellement confirmé que chaque mammifère marin qui a été capturé au Japon a d’abord fait l’objet d’une chasse au rabattage (drive hunt) vers les côtes pour qu’il s’y échoue.
L’industrie japonaise de la capture de cétacés est entre les mains d’unions locales de pêcheurs.
Les rabattages vers les côtes ne se pratiquaient initialement qu’en octobre et avril sous le prétexte de « contrôler les nuisibles ».
Les pêcheurs japonais s’imaginent en effet que c’est à cause de la présence de dauphins et baleines dans leurs eaux que la quantité de poissons disponibles diminue.
Depuis lors, une chasse constante, maintenue toute l’année, s’est développé pour approvisionner les delphinariums (Currey et al, 1990). Quelques animaux sont mis de côté et venus aux parcs marins pour quelques milliers de dollars, soit bien plus que ce que les pêcheurs pourraient obtenir de la seule viande du dauphin. (Hoyt, 1992). Les delphinariums rétorquent qu’en agissant ainsi, ils sauvent des cétacés qui, autrement, auraient été promis à la boucherie. En fait, si l’on en croit les gens de la région, ceux-ci sont au contraire encouragé à multiplier des rabattages vers les côtes, chasses qu’autrement, ils n’auraient pas menées.
Les cétacés mis de côté pour les delphinariums à partir du Japon meurent fréquemment peu après, le plus souvent durant le transport, soit du fait d’hépatites ou de désordres similaires contractés dans leurs eaux polluées d’origine, mettant ainsi en danger la santé du stock survivant aussi bien que de ceux qui les transporte.
Sweeney (1986) note que certaines épidémies telles que l’érysipèle, la pasteurollose, l’hépatite, le «pseudomonas pseudomallei» ou diverses formes de mycose ont pu dévaster un stock de dauphins avec 100% de décès « en moins de 48 heures ».
Plus de 20 soigneurs ont du ainsi être vaccinés d’urgence contre l’hépatite lorsque deux pseudorques moururent à Sea World (San Diego) en 1986 de symptômes semblables à l’hépatite.
Le Dr Brian Joseph, alors vétérinaire clinicien dans ce delphinarium, insista pour la mise en place de ce traitement, malgré l’avis négatif des autre officiels. Une série de trois injections de gamma globuline a été administré à l’équipe durant une période de 6 mois par le Dr Nat Rose, un docteur du secteur privé. Les frais engagés se sont élevé à plus de 1500 dollars par personne (Hall , communication personnelle).
Environ 33 pseudorques ont été capturés pour les delphinariums américains depuis 1963.
8 d’entre eux vivaient encore en 1995. Outre ces fausses orques, des espèces telles que le dauphin de Risso et de dauphins Tursiops aduncus du Pacifique ont été également capturées lors de chasses au rabattage, puis exportées vers les delphinariums des USA.
Impact des captures sur les populations sauvages
Un dauphin sur quatre…
Les effets de la capture sur les populations libres, aussi bien que sur les individus déplacés, restent encore mal connus. Cependant, nombreux sont les scientifiques qui pensent que ces effets ne sont pas négligeables. Il ne fait aucun doute que des pêches au rabattage telles que les Japonais la pratique sont génératrices de stress extrême et de souffrances.
En 1984, la Marine Mammal Commission et le Comité des Conseillers Scientifiques aux USA ont exprimé leurs préoccupations quant à l’impact que ces chasses précédant la capture peuvent avoir sur les populations de tursiops. Ils ont également souligné que les effets de ces opérations de collecte sont bien plus importants que ceux envisagés par les permis (Twiss, 1984).
La Commission a engagé le Service des Pêches Nationales à contacter les chasseurs de dauphins pour qu’ils fournissent le nombre et si possible le sexe des animaux poursuivis, encerclés, maintenus, relâchés ou retirés de leur milieu naturel endéans les dix jours qui suivent la chasse ». (Bumsted, 1984).
Le « ravisseur de dauphins » Jay Sweeney (1984) a répondu que « un tiers des animaux poursuivis et encerclés satisfont aux critères acceptables pour la captivité et sont retenus. Ceux qui ont atteint la taille qui convient sont âgés de deux à quatre ans et toujours associés à leur mère» confirmant que ce sont surtout les juvéniles qui sont demandés.
« Marine Animal Productions » (une société spécialisée dans la capture de dauphins) estimait pour sa part que : « pour chaque animal capturé, trois ou quatre sont encerclés, tirés à bord, examinés et relâchés » (Terell, 1991).
Les recherches de Wells (1990) sur les populations sauvages de Sarasota démontre que « les mères et leurs plus jeunes enfants restent étroitement associés au moins durant une moyenne de 5, 4 ans. La séparation survient le plus souvent lorsque le delphineau atteint l’âge de 5 à 8 ans, mais il peut ne pas s’éloigner du groupe avant 12 ou 16 ans. L’association mère/enfant fournit apparemment l’environnement et la protection nécessaire à la croissance et à la socialisation »
Bélugas
Les méthodes utilisées pour capturer les bélougas suggèrent la possibilité de grands dommages aux troupeaux, du fait de la proximité des nouveaux-nés auprès de leur mère lorsque que ces cétacés migrent en grand nombre dans les estuaires peu profonds où ont lieu les captures. Les mères bélougas gardent et protègent leur progéniture.
Les encerclements chaotiques de bélugas augmentent dramatiquement les risques de séparation brutale des mères et des nouveaux-nés, d’avortements spontanés chez les femelles enceintes et d’échouage pour certains individus du groupe.
Des études menées dans la Baie d’Hudson ont fait apparaître que plus de 54% des femelles examinées étaient enceinte, en train d’allaiter ou les deux. Des nouveaux-nés portant encore leur cordon ombilical ont été ainsi été trouvés à côté de leur mère suite à des échouages forcés lors d’études d’identification (Sergeant, 1973).
Les permis de chasse exigent aujourd’hui que soit estimé le nombre d’animaux poursuivis, encerclés, retenus temporairement, et relâchés en plus de ceux dont la capture a été autorisée.
Nous savons donc que les captures menées conjointement par le Mystic Aquarium et le New York Aquarium en 1984 ont permis la prise de 14 bélougas, dont 4 ont été conservés (Spotte, 1984).
En 1985, le Mystic Aquarium en a capturé 10 pour n’en conserver que deux (Overstrom, 1985). Les captures opérées en 1987 à l’initiative des Aquarium Nationaux de Baltimore et New York ont concernées 10 bélugas, dont trois ont été gardés. Deux de ces «prises» ont du être chassées pendant plus d’une heure avant capture (Cook, 1987).
Sea World a capturé, maintenu plus relâché 18 bélugas en 1988, pour n’en conserver que quatre sur l’ensemble (Asper, 1988). Le Shedd Aquarium a capturé, retenu puis relâché 24 de ces baleines blanches, pour n’en sélectionner que quatre sur l’ensemble en 1992 (Robinett). Parmi celles qui ont été relâchés, deux le furent « à cause d’une possibilité de maladie » détectée par une prise de sang (Boehm, 1992).
Le rapport d’après capture du Shedd Aquarium indiquait notamment :
«Tandis que les bateaux se rapprochaient peu à peu des cétacés, ceux-ci manifestèrent toutes sortes de comportements. Il nous sembla que le degré d’efficacité des tactiques d’évasion déployé par chaque béluga dépendait du fait qu’il ait ou non connu une expérience semblable par le passé. Les cétacés qui avaient déjà subi ces tentatives de capture étaient capables de changements de direction accompagnés d’accélérations brusques ».

Orques
Les spécialiste des orques, Peter Olesiuk (et al, 1990) a décrit les conséquences du retrait de certains individus hors de leur population d’origine : «Les analyses nous montrent, de manière surprenante, que la communauté des orques est davantage affecté par la capture de juvéniles que par celles d’animaux matures. Ceci est du au fait que ces jeunes ont un potentiel reproductif supérieur à celui des femelles adultes. De plus, le retrait d’un seul animal peut affecter gravement la survie de l’ensemble du groupe. Par exemple, la mort des femelles peut menacer l’ensemble de la progéniture qui dépend toujours d’elles ».
Les chercheurs ne furent d’ailleurs pas peu surpris de constater que les orques mâles demeurent auprès de leur mère durant toute leur existence. « Lorsque la mère disparaît, les mâles peuvent poursuivre leur association pour un temps, avec leurs soeurs. Mais ils meurent aussi quelquefois peu de temps après le décès de leur mère » (Balcomb, 1991).
La conclusion de Peter Olesiuk s’applique en fait aux autres cétacés, surtout depuis que les juvéniles et les mères de différentes espèces sont capturés en nombre proportionnellement excessif par rapport aux mâles.

Dauphins : une population au bord de l’épuisement
Le « Marine Mammal Commission » (cité par Scott, 1990) recommandait pourtant que « les prises de femelles ne doivent pas dépasser 50% des quotas autorisés. Ceci n’a pas été pratiqué dans les captures courantes, puisque 66% de tous les dauphins Tursiops retirés de leur milieu naturel ont été des femelles. Les captures qui se concentrent ainsi sur la partie femelle du stock augmente sensiblement le risque d’une sur-exploitation et diminue les possibilités de prises dans le futur ».
Les surveillances par avion et les observations menées depuis la côte ou un bateau, le marquage, la capture et diverses techniques de remises à l’eau ont été utilisés pour déterminer le quotas disponibles en fonction des régions.
Un certain nombre de personnes attachées aux parcs marins ont participé à de telles études, notamment Ed Asper et Dan Odell de Sea World et des «ravisseurs» professionnels indépendants, tels que Jay Sweeney et Moby Solangi (Scot, 1990).
Leurs contributions à ce type de recherches destinées à estimer les quotas semblent être à la base d’un autre conflit d’intérêts. La Marine Mammal Commission (1990) notait « qu‘il est peu probable que les captures d’exemplaires vivants et leur remise à l’eau avaient pu déterminer un déclin significatif des populations chez les dauphins Tursiops de l’Atlantique. Une menace beaucoup plus préoccupante est advenue durant le milieu de l’année 1987 lorsque un grand nombre de dauphins Tursiops ont commencé à s’échouer sur les plages, depuis le New Jersey jusqu’en Floride ».
Entre juin 1987 et mars 1998, plus de 740 dauphins tursiops furent en effet découvert à l’état de cadavre tout au long de la côte atlantique. Le National marine Fisheries Service estimait alors que cette mortalité massive était susceptible d’avoir réduit de près de 60% les effectifs totaux de toute la population migratrice des Tursiops vivant le long des côtes du moyen Atlantique.
En 1990, 297 dauphins tursiops se sont à nouveau échoués sur les plages du Golfe du Mexique depuis le Texas jusqu’au Nord-ouest de la Floride, suscitant la recommandation de ne plus capturer de dauphins de cette espèce à l’usage des delphinariums, avant que l’on ne découvre la cause de ces échouages.
Le 14 mars 1990, le Gouvernement fédéral prit la décision d’interdire toute capture de dauphins Tursiops dans les eaux du Golfe du Mexique, devant l’ampleur extraordinaire de ces échouages. Plus aucun dauphin Tursiops de l’Atlantique n’a donc été capturé aux USA pour les delphinariums depuis 1989.
En 1992, un nouveau lot de 609 dauphins Tursiops se sont échoués les long des côtes de l’Atlantique et du Golfe. Les échouages ont commencé à décroître vers 1993, néanmoins, l’évidence d’une infestation de ces animaux par le morbilivirus fut confirmée par l’analyse des tissus de cinq cadavres trouvés sur les côtes de l’Alabama et de la Floride.
De février à avril 1994, 220 Tursiops furent trouvés morts sur les plages du Texas.
En 1993, toute la population migratrice des grands dauphins vivant le long des côtes de l’Atlantique central était déjà considérée comme « épuisée ». Il faut par ailleurs noter que les chiffres des cadavres ne reflètent pas la totalité des décès, compte tenu des carcasses non retrouvées : il est possible que ces chiffres soient en fait six fois plus élevés.
Lorsque tous les facteurs évoqués ci-dessus sont pris en compte (i.e le fait d’enlever des dauphins à leur groupe puis de les y remettre, prise accidentelle de dauphins dans les filets et autres causes de décès dus aux humains, combinés avec les effets des poursuites et autres méthodes pour déterminer les quotas de dauphins disponibles pour les delphinariums, l’augmentation alarmante des échouages en masse et le fait que certaines populations soient dites «épuisées» ), il est clair que ces pratiques soulèvent des questions pertinentes quant à la stabilité des populations concernées.
Acclimation et transport

La caisse à dauphin
Selon le « ravisseur de dauphins » James Sweeney (1990), « la plupart des mammifères marins accueillis dans des enceintes fermées ont été prélevés en milieu naturel.
Peu d’entre eux ont donc eu l’occasion d’être exposés à un contact étroit avec des êtres humains et aucun n’a jamais été confronté au fait de se retrouver brusquement prisonnier d’un espace restreint. A ce stade, il devient nécessaire pour eux de faire face non seulement au traumatisme de la capture mais également à l’obligation de ne plus se nourrir que de poissons morts. Ils doivent aussi s’adapter aux nouvelles contraintes imposées à leur liberté de mouvement, étant placés dans des piscines privées des stimulations auditives ou visuelles propres à leur milieu naturel. Ils sont enfin amenées à découvrir et finalement à admettre le contact avec des êtres humains « .
En d’autres termes, tout ce qui va suivre le moment de la capture sera la mise en place d’une association forcée.
Sweeney a géré l’une des plus importantes opérations de capture menées aux USA en fournissant des animaux et son expertise en la matière à des clients du monde entier.
Sous la bannière de sa compagnie, Dolphin Services International, il offrait à ceux-ci la préparation des permis US, un entraînement étendu et l’hébergement des animaux ainsi qu’une garantie de remplacement en cas de décès dans les 90 jours. En avril 1989, Sweeney a renoncé à sa licence de vendeur UDSA, mais continue aujourd’hui à capturer des animaux pour des delphinariums étrangers.
Sweeney (1984) suggérait que le temps minimum de rétention pour acclimater un dauphin nouvellement capturé était de trente jours, si possible dans un établissement séparé.
Marine Animal Productions (Terell, 1991) estimait pour sa part qu’une telle période d’acclimatation peut s’étaler entre 30 jours et 3 moins ou même plus, afin de régler les formalités de transport et de permis.
Pryor (1975) qui fut un moment associé aux activités du parc marin Sea Life, décrivait la partie diététique de ce processus d’acclimatation : « Manger du poisson mort plutôt que de le chasser quand il est vivant représente l’un des plus terribles changements pour le dauphin. Au départ, le poisson mort n’est pas considéré comme de la nourriture.
Il faut donc recourir parfois au gavage forcé par intubation directe dans l’estomac afin de maintenir l’animal en vie jusqu’à ce qu’il accepte un type d’alimentation artificiel « .
W.H. Dudok van Heel recommandait que les animaux capturés soient amenés directement à leur destination finale et maintenus dans une piscine d’acclimatation pendant environ six mois (cité par Hoyt, 1992).
Transport
Alors que certains parmi les plus grands parcs marins qui transfèrent de manière fréquente des cétacés d’un établissement vers un autre, considèrent comme une simple « routine » ce type de transport, même les opérations les mieux organisées peuvent tourner à la catastrophe.
Le plus long transport en avion imposé à une orque dura 68 heures en 1968, c’est à dire 33 heures de plus que ce qui avait été prévu. Au moins deux orques durent attendre sur le tarmac, lorsqu’on se rendit compte que les caisses-cargo n’étaient pas prévues pour franchir les portes de l’avion (Howell, 1968, Taylor, 1977).
Deux dauphins Tursiops ont été transportés depuis le Long Marine Laboratory de Santa Cruz (Californie) jusqu’au Dolphin Research Center en Floride. En principe, un vol non-stop aurait du prendre six heures. Malheureusement, des arrêts eurent lieu à Columbus, Ohio et Orlando, Floride, de sorte que le voyage prit en fait 18 heures !
A l’arrivée, des lésions ouvertes pouvaient être observées tout au long des nageoires pectorales de l’un des dauphins.
Sweeney (1988) notait à ce propos qu’il existe une forte probabilité de blessures cutanées dues à la « nécrose de pression » lorsqu’on transporte de grands animaux et de forts risques de complications médicales quand on déplace des animaux plus âgés.
Le dauphin susmentionné mourut dans les trois semaines qui suivit son transport. Long Marine Laboratory fut tout de même frappé d’une amende de 500 dollars pour ne pas avoir assuré le transport de ces dauphins dans des conditions adéquates.
Un vol non-stop de 13 heures avait été prévu pour le transport de l’orque Ulysses (le père deMoana au Marineland d’Antibes) depuis Barcelone jusqu’à Sea World, à San Diego, en février 1994. Des retards dus à un équipement inadapté prolongea les souffrances de l’orque pendant quatre heures supplémentaires (Higuera, 1994).
Ken Ramirez (1991) a décrit le transport des deux premiers bélougas détenus au Shedd Aquarium, depuis Point Defiance (Tacoma) jusqu’à Chicago.
« Le plan de transport de dix heures que nous avions mis au point si méticuleusement se transforma en un marathon de 27 heures. Le mauvais temps commença à nous retarder (…) puis un camion de l’aéroport privé de frein percuta l’aile droite de notre avion.
Il nous fallut de longues heures avant de réparer cette avarie et de reprendre notre vol. Nous envisageâmes même de renvoyer les animaux à Tacoma et de reprogrammer un autre voyage. Mais comme les bélugas semblaient reposer paisiblement, nous décidâmes de continuer ».
Jean Michel Cousteau a commenté en 1993 la capture de trois dauphins à flancs blancs du Pacifique par le même Shedd Aquarium :
« Beaucoup de choses sont troublantes dans cette affaire de capture. Une fois installé dans un espace de confinement près de San Diego, les cétacés furent soumis à une procédure de » désensibilisation « , ce qui signifie, dans la littérature du Shedd Aquarium, un « processus calme et confortable » destiné à préparer ces mammifères marins hyper-nerveux à leur prochain voyage dans le Middle West.
En fait, il s’agit bien plutôt de deux semaines d’épreuves, durant lesquelles les dauphins sont nourris de force avec du poisson mort et progressivement habitués à subir des déplacements, ce qui implique qu’ils renoncent à la plupart de leurs comportements naturels afin d’être à même de survivre plus tard dans une piscine longue de trente pieds et profonde de huit.. «

Dauphins capturés au Japon déplacés par avion vers un delphinarium en Asie