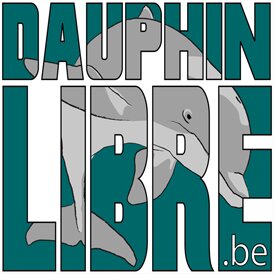La reconnaissance de soi chez les dauphins de laboratoire
La reconnaissance de soi chez les dauphins de laboratoire – c’est-à dire enfermés dans un delphinarium temporairement transformé en laboratoire de recherches – a fait l’objet de plusieurs études.
La plus récente, publiée le 10 janvier 2018 sous le titre Precocious development of self-awareness in dolphins, nous apprend que les delphineaux en bas âge sont plus précoces que les jeunes humains à réussir le test de la « reconnaissance de soi dans le miroir » et donc, à disposer d’une conscience de soi.
Cette découverte est due à deux chercheuses, Diana Reiss et Rachel Morrison, qui ont « travaillé » sur deux dauphins juvéniles à l’Aquarium National de Baltimore.
L’information n’a pas vraiment de quoi surprendre : elle s’inscrit logiquement dans le développement global plus précoce des cétacés après la naissance, pour des raisons de survie évidente.
La mer est un milieu où l’on ne peut se cacher et à cet égard, les antilopes, les chevaux ou même les éléphants, qui naissent également dans un milieu ouvert exposé à tous les prédateurs, font également preuve d’une telle précocité dans leur enfance.
On ne s’étonnera pas non plus de l’existence d’une « conscience de soi » chez les dauphins.
D’autres recherches ont établi que chacun d’entre eux porte un nom, leur «signature sifflée» par le moyen duquel il identifie leur moi propre et le désigne au reste du groupe. Une signature dont l’existence est d’ailleurs curieusement réfutée par la même Diana Reiss, qui ne travaille évidemment que sur des cétacés captifs lourdement acculturés, mais en aucun cas par les chercheurs de terrain en contact avec les dauphins libres.
Car si les recherches « en laboratoire » ont certes pu faire avancer quelque peu notre connaissance de la cognition chez les dauphins, c’est surtout au niveau éthique que celles-ci posent question.
Accepterions-nous de faire naître dans une cellule de prison de jeunes enfants humains, de les y enfermer toute leur vie et de nous livrer sur eux à des expérience scientifiques ? Certainement non. Mais pourquoi alors admettre ces pratiques sur des individus non-humains, dès lors que la recherche elle-même démontre à l’évidence qu’ils sont dotés de conscience de soi, d’une vie sociale complexe et d’un langage dont les clés nous échappent encore ?

La première confirmation d’une conscience de soi chez l’animal a été réalisé sur des chimpanzés. Aujourd’hui, de nombreuses espèces les ont rejoints.
Les résultats de la recherche
La Reconnaissance de Soi dans le Miroir, en anglais Mirror Self Recognition (MSR), constitue un indicateur comportemental bien connu de la conscience de soi chez les humains ainsi que chez quelques autres espèces, telles que les grands singes, les dauphins, les éléphants et les pies.
L’émergence de cette conscience survient généralement chez les bébés humains au cours de leur deuxième année. Elle est directement corrélée à leur développement sensorimoteur et à leur conscience sociale grandissante. Chez les chimpanzés, une telle reconnaissance de soi n’apparaît qu’entre 2 ans et 4 mois et 3 ans et 9 mois.
Quant au grand dauphin de l’Atlantique, libre ou captif, d’autres recherches ont certes révélé une prise de conscience sociale et sensorimotrice précoce au cours des premières semaines de vie, mais aucune recherche comparative n’avait été menée jusqu’à présent à propos de leur capacité à se reconnaître dans un miroir.
La reconnaissance de soi dans le miroir avait certes déjà été démontrée chez deux dauphins adultes par Diana Reiss et Lori Marino en 1998. Cependant, aucune étude comparative sur le moment de son apparition chez les delphineaux n’avait encore été produite.
On sait que durant les premières semaines qui suivent l’accouchement, les dauphins se développent très vite au niveau sensorimoteur, musculaire et sociale. Ainsi, les muscles locomoteurs d’un delphineau nouveau-né sont similaires à ceux d’un adulte.
Dès l’âge d’un mois, les dauphins présentent un développement précoce de la proprioception – perception du corps propre – qui leur permet une coordination motrice avancée. Quant à la conscience sociale, elle augmente significativement au cours des semaines suivant la naissance, lorsqu’ils synchronisent leur nage et leur respiration avec celles de leur mère, la reconnaissent comme telle et la rejoignent lorsqu’ils sont séparés.
Comparés aux primates humains et non humains en bas âge, les dauphins interagissent aussi beaucoup plus tôt avec les autres membres de leur groupe social.
À la fin de la première semaine de vie, les jeunes dauphins en liberté s’engagent déjà dans des jeux sociaux avec des individus autres que leur mère. En fait, c’est durant la première année post-partum que le nombre d’associations avec différents individus du groupe atteint un sommet. Des recherches cognitives menées auprès de jeunes dauphins en captivité montrent également qu’à la fin de leur première année, ceux-ci manifestent une forte propension à l’apprentissage vocal et social, deux aptitudes susceptibles de renforcer leur conscience de soi et des autres.
Pour les besoins de l’expérience, deux jeunes dauphins ont été exposés à un miroir sans tain en même temps que leur groupe social de sept autres dauphins détenus à l’aquarium national de Baltimore.
Il s’agissait de Bayley, une petite femelle âgée de 3 mois et demi, et de Foster, un mâle de 14 mois. Les séances se sont déroulées du 21 novembre 2008 au 15 décembre 2011 et ont duré environ 1 heure chacune à raison d’un jour ou deux toutes les deux semaines à 9 heures du matin, avant l’arrivée du public et le début des shows.
Suivant le paradigme utilisé dans une étude précédente rapportant la MSR chez deux dauphins adultes, plusieurs marques ont été effectués avec chaque dauphin après que les comportements auto-dirigés aient été bien documentés.
Au cours des séances , les dauphins ont été exposés au miroir pendant environ 15 minutes. Les chercheurs ont ensuite demandé aux entraîneurs de s’approcher de la piscine et de faire signe aux dauphins de se placer du côté opposé à la glace. En utilisant soit un marqueur temporaire non toxique à l’encre noire, soit un rouge à lèvres noir, un seul dauphin a été marqué avec une marque triangulaire ou en forme de X de 6. 4 cm par leurs entraîneurs sur différentes parties de leur corps qu’ils ne pouvaient pas voir en l’absence du miroir. Plus précisément, les dauphins étaient marqués de chaque côté de la tête derrière les yeux, sur la face palmaire de l’une de leurs nageoires pectorales ou sur leur surface ventrale entre leurs nageoires pectorales. Après l’application de la marque, le dauphin marqué et d’autres dauphins ont été libérés de la station et des enregistrements vidéo ont continué de documenter les comportements des dauphins devant le miroir.
Les conclusions de l’étude sont formelles : les deux dauphins ont manifesté les signes d’une MSR, indiquée par un comportement auto-dirigé vers le miroir, à des âges plus précoces que ceux rapportés chez les enfants et encore beaucoup plus précoces que chez les chimpanzés. L’apparition de cette conscience de soi chez ces jeunes cétacés se produit parallèlement à un développement sensorimoteur avancé, à des interactions sociales complexes et réciproques et à leur prise de conscience de soi au sein du groupe.
Les sujets de la recherche
Voilà une belle avancée scientifique. Mais que sont devenus les dauphins captifs utilisés pour cette expérience, fort amusante pour eux ?
Ce genre d’article mentionne rarement ce genre de détails, qui valent pourtant d’être rappelés.
Commençons par Foster et Bailey. De leur côté, rien que des bonnes nouvelles ! En 2020, ils rejoindront avec leur famille le premier sanctuaire pour dauphins captifs jamais réalisé. Fini les shows, ils vivent désormais dans de la véritable eau de mer chargée d’algues et de poissons, ils sentiront la pluie tomber sur leur évent et plongeront aussi profond qu’un dauphin peut le faire dans une crique fermée des Florida Keys.
Par contre, lorsque Diana Reiss évoque dans son étude sa première découverte en 1998, elle a raison de ne pas s’étendre sur la suite.
Lori Marino et Diana Reiss formaient naguère un duo de choc. L’une et l’autre sont d’éminentes spécialistes en neurobiologie des cétacés. Mais lorsque l’une continue à travailler aujourd’hui encore sur des sujets captifs, l’autre a claqué la porte des delphinariums et n’a de cesse de dénoncer les recherches en laboratoire.
Il faut savoir qu’après avoir récolté les fruits de cette découverte – qui nous semble évidente aujourd’hui, comme s’il fallait tester la conscience de soi d’un Martien arrivé en soucoupe volante – les deux chercheuses envisagèrent de perfectionner encore leurs recherches.
Lorsqu’elles revinrent au Brooklyn Aquarium, on les informa que Tab et Presley avaient été transférés séparément vers d’autres delphinariums et que tous deux avaient fini par mourir.
Ces deux décès troublèrent beaucoup Lori Marino.
Elle quitta son travail au Zoo de Brooklyn – lequel a d’ailleurs renoncé aux dauphins depuis lors -, coupa le contact avec Diana Reiss, qui travaille aujourd’hui au Baltimore Aquarium, et se lança dans une croisade pour libérer tous les dauphins captifs. Ce qui lui valut de se mettre à dos une bonne partie de la communauté scientifique.
Ecoutons son témoignage :
« Notre précédent article, daté de 2001, montrait que deux grands dauphins nés en captivité – Presley, âgé de 13 ans, et Tab, âgé de 17 ans, résidant à l’aquarium de New York à Coney Island – avaient fait preuve d’une reconnaissance de soi indépendante, fournissant la première preuve de cette capacité chez cette espèce.
Tab et Presley firent alors la Une de la presse et devinrent membres du club des «cétacés superstars de la recherche », qui avaient déjà démontré d’autres capacités cognitives telles que la compréhension du langage et la métacognition.
La souffrance et la mort de ces deux dauphins ont mené à ma décision de ne plus participer à la recherche sur les animaux en captivité.
En 2001, je commençais à comprendre peu à peu le sens profond de ce que Diana et moi venions de démontrer.
A savoir que deux êtres conscients avaient passé toute leur vie à nager en rond un petit bassin stérile à Brooklyn. Quelques années plus tard, Presley et Tab furent transférés vers d’autres établissements de contention. Ils moururent l’un et l’autre de manière prématurée, du fait de maladies liées au stress, au dysfonctionnement de leur système immunitaire et à l’infection.
Presley a succombé à une encéphalite fongique à 19 ans et Tab est mort d’une gastro-entérite à 21 ans.
Les souffrances et la mort de ces deux dauphins avec lesquels j’avais travaillé si étroitement m’ont incité à prendre la décision de ne plus participer à des recherches sur les animaux en captivité. Je savais que cela aurait un coût personnel, car nos conclusions avaient soulevé tellement de questions brûlantes que davantage de recherches seraient en mesure d’explorer. Mais la découverte de la reconnaissance de soi et de tous les autres résultats de la recherche en captivité n’a fait que rendre évidente le fait que ces animaux ne sont pas faits pour vivre dans des aquariums.
L’importance scientifique des travaux actuels de Morrison et de Reiss ne saurait être surestimée. Mais sa pertinence en tant qu’exemple de notre évolution éthique est encore plus importante. Ces travaux démontrent en effet que les découvertes scientifiques ont des implications éthiques.
Ce que j’ai appris lors de nos recherches en 2001 m’a conduit à ce qui est aujourd’hui le travail du Whale Sanctuary Project, afin que d’autres cétacés – en particulier des orques et des bélugas en captivité – puissent avoir une vraie vie qui satisfasse tous leurs besoins psychologiques.
Il est temps pour nous tous d’aller au-delà des limites des «dauphins de laboratoire» et d’entrer dans un monde qui fasse écho à ce que nous savons désormais de ces êtres ».
La synchronisation des gestes et du souffle chez les dauphins
Dauphins : trop intelligents pour être captifs, selon le Dr Lori Marino
Pourquoi les zoos et les delphinariums doivent devenir des sanctuaires
Panama s’est éteinte dans les bassins du Clearwater Marine Aquarium
Dolphin Mirror Self-Recognition: the Science and the Ethics