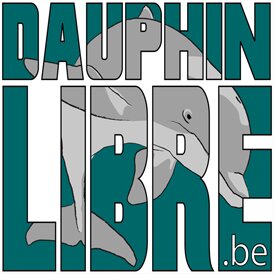Cachalot : intelligence, vie sociale et langages

La vie quotidienne du cachalot à l’île Maurice
Pourquoi les cétacés sont aussi des personnes
Nations et langages chez les cachalots
Le plus grand cerveau du monde
La langue codée des cachalots
Le cachalot a-t-il fait la preuve de son intelligence ?
Cachalots voleurs de morues en Alaska
Cachalot ambassadeur

Septembre 2015
Une nouvelle étude confirme que les jeunes cachalots parlent le langage des plus anciens
par le biais d’un apprentissage culturel
Nations et langages chez les cachalots

Paroles de cachalots
Aujourd’hui, la preuve vient d’être faite que certaines espèces de cétacés peuvent s’exprimer en divers dialectes selon les régions du monde qu’elles habitent. Cette découverte ne manque pas de conforter, bien évidemment, l’hypothèse que ces animaux, tout comme les humains, disposeraient de plusieurs nationalités et de plusieurs cultures s’étendant sur d’immenses territoires marins.
Une nouvelle étude canadienne démontre en tous cas que si un cachalot isolé voyage couramment sur de très vastes distances et rencontre à cette occasion d’autres individus de la même espèce mais s’exprimant en un autre dialecte, il ne formera néanmoins de liens sociaux forts qu’avec ceux qui partagent sa propre culture.
« Nous avons pris l’habitude de croire que le comportement des animaux non-humains est déterminé par leurs gènes et par les conditions de vie de l’endroit où ils sont nés, et nullement par une quelconque » culture « , rappelle le professeur Hal Whitehead, biologiste à l’Université de Dalhousie. « Ce que nous avons découvert contredit cette idée : les cachalots appartiennent à des « clans vocaux » qui présentent nombre de parallèles avec les groupes linguistiques que l’on trouve chez l’homme «
Jusqu’à présent, l’équipe de Hal Whitehead a déjà découvert l’existence d’au moins six groupes distincts : l’un résidant dans les Caraïbes et cinq autres dans le Pacifique sud, les territoires de ces derniers se chevauchant par ailleurs.
L’une de ces nations semble occuper un espace compris entre l’Est du Pacifique sud et la Nouvelle-Zélande, alors qu’une autre existe seulement aux alentours des îles Tonga.
L’équipe de l’Université de Dalhousie navigue dans ces régions du Pacifique sud depuis 1985, enregistrant avec soin les vocalisations des cachalots à l’aide de microphones. L’indice principal prouvant qu’il existe bien différents groupes culturels est le fait que les cachalots parlent de manières distinctes.
Les cachalots plongent à des profondeurs impressionnantes afin d’aller chasser le calmar. Puis ils reviennent en surface pour se reposer et socialisent par groupe de deux douzaines d’individus qui bavardent entre eux. Ainsi, les membres d’un clan vivant non loin des îles Galapagos s’expriment verbalement à l’aide d’une longue série de déclics régulièrement espacés. Ceux appartenant à un groupe voisin utilisent une toute autre série de clicks, assortie cette fois d’une petite syncope à la fin de la phrase. Un troisième groupe, enfin, communique à l’aide d’explosions sonores beaucoup plus courtes, et ainsi de suite…
Les cétacés parlent entre eux au sein de ces clans. Mais il semble que les groupes qui n’utilisent pas le même dialecte évitent de se mélanger et de socialiser. Peut-on dire que cette étude sur les cultures cétacéennes met à mal notre distinction traditionnelle entre l’animal et l’homme ?
« Je le pense » affirme Luc Rendell, un doctorant de l’Université de Dalhousie qui a participé à cette enquête. « Nos résultats suscitent des discussions plutôt chaudes parmi des scientifiques, on s’en doute car nous pensons les cétacés se débrouillent pour survivre essentiellement grâce à leurs acquis culturels. La chose la plus impressionnante est la taille importante de ces entités sociales, de ces clans linguistiques : nous n’en avons sans doute trouvé que cinq sur toute l’étendue du Pacifique Sud mais il faut bien se rendre compte que nous parlons ici de près de 100.000 cétacés, soit une bonne dizaine de milliers d’animaux pour chaque clan » ajoute le chercheur, qui précise « Cela signifie qu’une même culture a été transmise d’une génération à l’autre par des milliers d’animaux vivant à des centaines de kilomètres l’un de l’autre et qui ne se rencontreront peut-être jamais. Dans le même temps, des cachalots utilisant des dialectes différents partagent parfois les mêmes zones du même océan mais n’interagissent jamais ensemble ».
Les chercheurs sont évidemment très prudents lorsqu’il s’agit de désigner ces différents groupes de sons sous le terme « langage « , puisqu’ils ignorent encore s’il existe ou non l’équivalent d’une grammaire ou d’un vocabulaire au sein de ces modes d’expression.
Génétiquement, il n’y a aucune différence significative entre ces différents groupes de cachalots. Ceux-ci vivent partout dans les océans, là où se trouvent des failles profondes et les chercheurs qui les observent découvriraient sans doute d’autres groups dialectaux s’ils poursuivaient leur travail sur l’ensemble des océans de la planète, dans l’Océan Atlantique ou dans le Pacifique Nord, notamment.
Par ailleurs, certains indices laissent à penser que les cétacés peuvent parfaitement apprendre la culture et les dialectes d’un autre groupe que le leur. Il y a de cela quelques années, des scientifiques ont ainsi pu constater que des baleines à bosse, qui avaient émigré de l’ouest à l’est de l’Australie ont rapidement enseigné aux baleines présentes sur place à chanter d’une nouvelle manière.
« Cela a du leur faire l’effet d’une révolution culturelle « conclut Luc Rendell, dont l’étude vient d’être publiée par le journal scientifique anglais « The Proceedings of the Royal Society »
Traduit de « Whale culture: Distinct dialects » by Tom Spears.
Ottawa Citizen Saturday, December 21, 2002
CREDIT: Chris Bangs, Associated Press
Lire aussi :
Les cachalots s’interpellent par leur nom !
Cachalot : le plus grand cerveau du Monde

Cliché d’après « Smarter than man ? Intelligence in whales, dolphins and Humans » by Fichelius and Sjolander 1974
Cerveau et vie sociale
Le cerveau d’un cachalot est d’environ 60% supérieur en masse absolue à celui d’un éléphant.
D’un poids moyen de 8, 2 kilos pour un corps de 15 mètres, l’encéphale sphérique du cachalot est proportionnellement plus lourd que celui de tous les autres cétacés. Il est aussi le plus complexe : son cortex frontal est plus riche en circonvolutions, en scissures et en « gyrus » divers que celui de n’importe quel autre mammifère au monde, en ce compris l’être humain !
Un cerveau d’une telle taille ne s’explique pas aisément : le requin baleine, qui est énorme, se contente d’un cerveau de poussin. Quant à la chauve-souris, tout aussi habile que le cachalot en matière d’écholocation, son crâne est gros comme une noisette. Rien n’indique que cet organe ait à traiter les données acoustiques de manière singulière. Les zones sensorielles sont relativement réduites en regard des zones associatives situées sur l’avant et les côtés du crâne et dévolues, comme chez l’homme, au langage et à la réflexion.
De l’aveu même du biologiste A.A. Bezin, affecté aux autopsies sur les baleiniers russes «le cerveau du cachalot est tel que l’on peut dire de cet animal qu’il pense et qu’il est capable de faire preuve de hautes capacités cognitives».
Pourtant, la vie quotidienne du cachalot paraît simple et ne semble guère exiger de compétences cognitives exceptionnelles. La nourriture abonde encore dans l’océan et, à l’exception de l’homme et de certaines orques voyageuses, le cachalot ne connaît pas d’ennemi.
Eduqué par sa mère et son clan féminin au sein de petites crèches bien protégées, le jeune cachalot fait l’objet de soins tendres et attentifs. Vers 15 ans, à la puberté, les juvéniles de sexe mâle quittent le giron maternel.
Tandis que les femelles restent groupées par familles sur la ligne d’Equateur, eux remontent en bandes vers le Nord ou le Sud, au gré de leur fantaisie et au prix de nombreux risques.
Ils y séjournent durant quelques années, le temps d’acquérir la taille et le poids qui feront d’eux des adultes, c’est à dire à l’âge de …35 ans puis s’en retournent vers les tropiques. Ils y retrouvent leur famille puis s’en vont en visiter d’autres, lutinant au passage de jeunes femelles exogamiques.
Pour quelques uns d’entre eux, les plus énormes, les plus vieux, les retours se font pourtant toujours plus brefs, plus rares et bientôt, ils demeurent à jamais dans ces retraites polaires, achevant leur vie centenaire sous les glaces des banquises…
Que peuvent faire là-bas ces « polar bulls », durant ces décennies de solitude absolue dans la nuit boréale ? A quoi occupent-ils donc leur temps ? Dorment-ils ? Méditent-ils ? Nul ne le sait.
En fait, on sait peu de chose des cachalots.
Les premières études sur le terrain n’ont commencé qu’avec Hal Whitehead, il y a de cela quelques années.
Jusqu’ici, les études se fondaient uniquement sur les autopsies menées à l’occasion des échouages et sur les rapports insoutenables des scientifiques présent sur les baleiniers. Ces anecdotes ne livrent qu’un aspect de la vie des cachalots mais elles attestent à coup sûr de dévouement, du courage, de la formidable « humanité » des ces géants des mers.
Si le cachalot est un être bon, doux avec ses semblables et soucieux de les aider, il peut aussi se montrer féroce.
Seul parmi les autres cétacés, il n’hésite pas à attaquer l’homme pour défendre les siens.
Le cas était fréquent lors des grandes chasses du 19ième siècle, où des Moby Dick furieux venaient rageusement heurter du front les coques en bois de baleiniers et achevaient les matelots en les assommant à coups de queue. Aujourd’hui, bien sûr, une telle bravoure est inutile face aux harpons explosifs et aux coques en acier.
Hal Whitehead, bien entendu, ne tue pas ses sujets d’étude. Il navigue sur un petit voilier, il les observe et il les enregistre. C’est qu’à l’instar du dauphin, le cachalot parle, lui aussi. Il s’exprime en une langue qui ressemble à Code Morse.
Les clicks très réguliers ne servent qu’à l’écholocation tandis que les plus explosifs ne sont utilisés que pour assommer les proies. Mais lorsqu’il salue l’un de ses congénères ou lui transmet une information, le cachalot émet ses clicks de manière différente.
Ceux-ci s’alternent alors en séquences longues, brève, distantes, rapprochées qui font sens et dont le bruit peut rappeler le son d’une trompette, d’une porte qui claque, d’une foule qui applaudit ou d’une mitrailleuse qui crépite ! On l’entend de tout en bas, sous mille mètres de fond, échangeant, saluant, désignant certaines choses à l’aide de certaines phrases et selon certains dialectes régionaux, mais personne à ce jour n’a encore compris toutes les nuances de ce type de communication.
Le cachalot danse, également : en groupe près de la surface, son corps rigide dessine des figures lentes en forme de rosace, il s’inverse, se place en oblique, ne laisse paraître que son museau, bref, il crée de la sorte tout un alphabet d’attitudes insolites, dont là encore, le sens qui nous échappe.
Enfin, certains baleiniers racontent que lorsqu’un cachalot est touché à mort par un harpon, il se redresse toujours une dernière fois hors de l’eau vers le ciel et qu’il fait face au soleil, toujours, avant de rendre son dernier souffle…
En fait, tout nous échappe de la vie du cachalot.
L’essentiel de son temps, il le passe dans un autre monde, aussi étrange pour nous qu’une autre planète, là où l’homme ne va pas, où il ne peut pas survivre et où seul, de temps en temps, un bathyscaphe caparaçonné d’acier ose descendre.
Dans la nuit de Abysses…
Le monde des ténèbres
Les grands fonds sont le plancher de cette planète. C’est un monde plat et pâle, parfois fendu de fosses, territoire continu, infini, identique, partout inchangé depuis l’aube des temps et où survivent encore des espèces vieilles de plusieurs millions d’années.
Dans la nuit des grands fonds, il fait froid, l’eau y est très salée, les courants infiniment faibles, l’obscurité totale, la pression effroyable, plusieurs centaines de fois celle que nous supportons à l’air libre.
Les animaux se déplacent peu dans cette glu d’encre : puisqu’ils ne disposent que de peu d’oxygène, ils économisent
leurs mouvements et ne chassent qu’à l’affût.
La plupart d’entre eux ont des allures de monstres : mâchoires démesurées hérissées de crocs pointus, corps luminescents qui se dilatent autour de leur proie, photophores éblouissants suspendus devant la gueule, guirlandes translucides insensées qui dérivent avec lenteur…
La faune la plus commune y est de petite taille, mais selon les rares chercheurs qui se sont aventurés si bas, des créatures géantes y pulluleraient, qu’ils ont entraperçu sous forme d’ombres immenses.
Le calmar géant Archytheutis y a ses aises, en tous cas. On a découvert sur le corps de certains cachalots ses tentacules interminables plus de 100 mètres parfois attestant de féroces combats menés au fond de la nuit.
Existe-t-il encore d’autres monstres de la sorte ?
Les nouveaux engins d’exploration sous-marine nous le diront bientôt.
Le cachalot ne craint pas ces conditions inouïes ni ces titans de l’infra-monde.
Lorsqu’il descend sous 2.000 mètres, voire 3.000 gardant son souffle pour plus d’une heure ! – sa peau ordinairement fripé se tend comme celle d’un tambour. Il coule au plus profond et se couche, pense-t-on, pour guetter sa proie et l’avaler d’une seule succion.
Son système d’écholocation lui permet de voir dans les ténèbres mais pas les pieuvres, justement, dont la masse molle est perméable au sonar et donc invisible. Comment fait-il pour les attraper ? On ne le sait pas encore.
Pour lui, ces Abysses ne sont pas seulement un terrain de chasse giboyeux mais c’est aussi son monde, son univers le plus familier, le lieu où il passe le plus clair de son temps, entre 500 et 1000 mètres pour les chasses ordinaires.
On peut imaginer que la conjonction d’une telle réalité vécue avec la puissance de calcul d’un cerveau géant ne peut rester sans conséquences. Quel est le «monde mental » d’une créature aussi puissamment armée de neurones dans un milieu aussi exotique, aussi suprêmement étranger à celui que nous connaissons ?
Quel usage y fait-elle de son cortex phénoménal, de son rhinencéphale capable d’abriter la mémoire de l’ordinateur Big Blue, de son langage codé ? Quelles pensées inouïes, quels concepts, quelles intuitions inaccessibles à notre compréhension, ces structures cérébrales surdéveloppées produisent-elles ? Ont-elles gardé le souvenir des temps anciens, des légendes de cette ère Tertiaire où nous n’étions encore que de petits singes proconsuls ?
Pour la science actuelle, rappelons-le, et selon la récente théorie des cordes, nous vivons tous au sein d’un monde doté de onze dimensions, mais notre perception n’accède qu’à quatre d’entre elles, à savoir trois d’espace et une de temps. Notre vision du monde est donc incomplète : c’est celle d’une race faite pour la forêt, munie d’une bonne vision des couleurs et du relief, mais affligés, par exemple, d’une audition bien inférieure à celle des cétacés. Il en est sans doute de même aux niveau des compétences cognitives supérieures.
Ainsi, un chat comprend mal pourquoi son maître passe tant de temps assis devant l’ordinateur ou un livre à la main. Pour lui, ces comportements n’ont aucun sens et il trouve bien ennuyeux que les humains se livrent à de tels passe-temps.
Pourquoi ? Parce que son cerveau est nettement plus petit que le nôtre, nettement moins riches en circonvolutions et en structures associatives. Outillé de cette manière, le chat ne saurait concevoir des notions telles que l’écriture ou l’informatique.
De la même manière, on peut supposer que devant ce corps énorme immobile à fleur d’eau, devant ce léviathan paisible et paresseux qui ne fait rien apparemment d’autre que nager, manger et se reproduire, nous autres humains, ultimes surgeons dans la course à l’intelligence, nous ne puissions jamais comprendre les profondeurs abyssales de la «Conscience Cachalot».
Le cachalot a-t-il déjà fait la preuve de son intelligence ?

Un texte extrait de l’ouvrage « Smarter than man ? »
(« Plus intelligent que l’homme ? »)
de Karl-Erik Fichtelius and Sverre Sjolander
Publié chez Random House, Ballantine books, New York, 1974
« Nous ne possédons aucune preuve définitive de ce que le cachalot soit intelligent au sens où nous l’entendons.
En fait, notre connaissance des cétacés est très incomplète. Tout ce que nous pouvons faire à ce stade, c’est rapporter une anecdote étonnante concernant le comportement des cachalots, comportement que l’on peut qualifier d’intelligent, à supposer qu’une telle chose soit possible.
Dans son ouvrage « La Croisière du Cachalot », publiée en 1897, Frank T. Bullen raconte un incident survenu à la fin du dix-neuvième siècle. L’observation a été faite à partir d’un baleinier qui rentrait d’une longue expédition.
Tout le navire était couvert par les carcasses des cachalots harponnés puis tirés hors de l’eau. La chasse avait été manifestement fructueuse et plus aucune autre prise n’était envisageable. Il n’y aurait plus eu de place pour cela.
« C’est alors qu’une troupe de cachalots a commencé à s’ébattre autour du bateau, apparemment consciente du fait qu’aucune chasse n’était plus à craindre de notre part « écrit Bullen, qui précise que l’équipage tout entier fut témoin de cette scène mystérieuse.
« Toute la troupe fit cercle autour du navire puis se mit à exécuter les plus étranges mouvements que l’on puisse imaginer. C’était comme si une impulsion commune les habitait tous en même temps.
Les cachalots dressèrent leurs têtes carrées au-dessus de la surface et demeurèrent un long moment dans cette position. Solennellement, leurs corps montaient et descendaient, dans un mouvement de va et vient vertical continu, semblables à d’énormes rocs noirs mobiles et dotés de vie au milieu des vaguelettes éclaboussées de soleil.
Tout à coup, avec un ensemble parfait, les cachalots inversèrent leur position.
Leurs immenses caudales s’élevèrent alors en direction du ciel, agitées simultanément d’un même mouvement rythmique, comme autant de machines synchronisées l’une à l’autre.
Leur calme était parfait et chaque mouvement de ces grands mammifères put être longuement observé par chacun.
Parfois, un cétacé passait si près des flancs du bateau que nous pouvions voir de quelle manière sa mâchoire inférieure, généralement invisible, s’articulait à la tête ».
Ce spectacle, qui dut être en effet une expérience fantastique, se prolongea plus d’une heure, jusqu’à ce que tous les animaux disparaissent brusquement d’un seul coup, comme sur commande.

Le récit de Bullen a eu lieu en 1897, à une époque où les êtres humains massacraient déjà les cétacés depuis plus deux siècles.
On peut dès lors se demander pourquoi les cachalots ont réservés cette prestation surprenante à un baleinier qui rentrait au port chargé de son lot de victimes.
Sans nul doute, les cétacés se rendaient certainement compte de la présence du bateau. Au-delà de ce fait, il existe peut-être une explication qui peut rendre compte de leur comportement sans faire appel à l’intelligence, mais pour notre part, nous ne la connaissons pas.
En revanche, si l’on part de l’hypothèse que le cachalot est un être intelligent doué de raison et de sens social, nous pouvons mieux concevoir le sens de cet étrange comportement.
Il est possible que, d’une façon ou d’une autre, les cétacés aient compris que cette fois, ils ne seraient pas attaquées ou du moins, que ce danger était moindre.
Ils ont pris le risque d’offrir aux humains un spectacle gratuit et ceci dans le but d’attirer leur attention sur le fait que les cachalots n’étaient pas des poissons ordinaires et stupides, mais bien des créatures hors du commun, privées certes de ces mains qui créent les harpons, mais dotées d’autres qualités, comme celle d’être capable de coopérer de manière parfaite.
Le futur nous apprendra si cette explication n’est pas trop imaginative… à moins que ce ne soit le récit même de Bullen, qui aurait inventé cette scène. On pourrait aussi se demander si le comportement curieux des cachalots qui se regroupent en étoile, ainsi qu’on a pu l’observer plusieurs fois, ne relève pas du même registre d’explications ».
Un texte extrait de l’ouvrage « Smarter than man ? »
(« Plus malin que l’homme ? »)
de Karl-Erik Fichtelius and Sverre Sjolander
Publié chez Random House, Ballantine books, New York, 1974
Merci à Gauthier Chapelle de me l’avoir fait connaître.
CACHALOTS VOLEURS DE MORUE
Une nouvelle forme d’adaptation à la présence humaine

La morue charbonnière
Les cachalots ont le plus gros cerveau du monde et on leur reconnaît une vive intelligence.
Ceux qui vivent dans le Golfe de l’Alaska viennent d’en fournir une nouvelle preuve en laissant des pêcheurs humains faire tout le travail pour eux au moment des repas.
Ils démontrent ainsi que, loin d’être des animaux d’un autre âge incapables d’évoluer comme le sont hélas le koala, le panda ou même l’éléphant d’Afrique, les cachalots sont au contraire capables de s’adapter rapidement aux modifications de leur environnement et à la présence envahissante de l’Homme sur tous les océans.
Après avoir fait l’objet d’un formidable génocide baleinier qui a failli décimer la totalité de ces bons géants marins et magré les chasses sporadiques qui se poursuivent aujourd’hui – les Japonais chassent ENCORE le cachalot ! – cette espèce courageuse est parvenue à remonter la pente et à regarnir peu à peu ses effectifs.
Aujourd’hui, les cachalots sont à nouveau « relativement » nombreux et souvent, on les retrouve massés dans les lieux où on les protège et où se pratique le whale-watching.
Reste à savoir à présent s’ils pourront résister à des ennemis pires encore que les féroces baleiniers, à savoir: la pollution chimique et sonore des eaux des océans, un autre fléau d’origine humaine…
Des chercheurs enquêtent aujourd’hui sur un phénomène que les pêcheurs locaux soupçonnent depuis longtemps, à savoir que les cachalots seraient capables de décrocher de leurs hameçons attachés à une longue ligne de pêche, ces morues charbonnières (« sable fish » ou « black cod » en anglais) dont ils font un festin.
Personne ne comprend non plus pourquoi les cachalots, ces grands mangeurs de calamars, se sont intéressés aux morues charbonnières, dont la chair grasse, huileuse, est devenu un produit d’importation important sur le marché japonais.
Biologistes et pêcheurs commerciaux se sont donc associés sous l’égide du North Pacific Research Board et grâce à un financement de 200.00 dollars, ceci afin d’en savoir plus.
« Nous ne voulons pas que les pêcheurs perdent de l’argent », a expliqué M. Jan Straley, un spécialiste des cétacés chargé de mener les recherches dans le Golfe « mais ce comportement provoque aussi une certaine perte en termes biologiques, car nous ignorons combien de ces poissons sont ainsi dérobés. Mon premier intérêt est d’ordre scientifique, j’aimerais comprendre comment les cachalots s’y prennent ! « .
Pour récolter la morue charbonnière, les pêcheurs immergent une ligne longue de deux miles (1 mile = 1,609 km ) avec des hameçons munis d’appâts tous les 3 à 6 pieds (1 pied = 30,48 cm).
L’extrémité de chacune de ces lignes est ancrée dans le fond marin le long du plateau continental, tandis que l’autre bout est attaché à une bouée en surface. Au terme de 8 à 12 heures, on remonte la ligne et avec elle, souvent, plusieurs centaines de poissons gras.
Durant ces dernières décennies, certains cachalots du Golfe ont observé le manège.
Ils ont apparemment compris que les pêcheurs allaient rechercher de la nourriture depuis les grands fonds jusqu’à la surface et appris comment décrocher délicatement de leur hameçon des morues de 20 à 30 pouces de long (1 pouce = 2,54 cm).
Pas mal pour des créatures de 35 tonnes nettement plus grandes qu’un autobus !
Leurs prélèvements ne sont pas d’ailleurs minces : c’est près de 20 à 25 % de la prise globale qui est perdue pour les pêcheurs.
Les cachalots trouvent leurs proies grâce à leur audition extraordinaire.
Ils percoivent leur environnement par le moyen de leurs clicks écholocatoires. Cela ne les empêche pas, cependant, de s’empêtrer parfois dans les dispositifs de pêche ou de s’y blesser gravement, selon les témoignages de pêcheurs et de biologistes marins.
Les découvertes de Straley et de ses associés suggèrent que les cachalots mâles patrouillent le bord du plateau continental, où les fonds descendent de 1.200 à 3.000 pieds (1 pied = 30,48 cm), dans l’attente des bateaux de pêche.
Ils les accompagnent aussi quelquefois à distance, relevant la tête hors de l’eau de temps en temps et observant les navires de leurs yeux gros comme des ballons.
« C’est sûr qu’ils reconnaissent le bruit des moteurs quand les navires s’approchent et que les lignes se déroulent.
C’est un peu comme la cloche du dîner pour eux ! » a conclut Linda Behnken, la directrice de l’association des
pêcheurs de l’Alaska Longline, qui coordonne l’étude. « Chacun sait que ces baleines sont futées et là, elles le prouvent ! » a-t-elle ajouté.
D’après une dépêche de l’agence Reuters et d’un article du Daily-News Miner (Anchorage, Alaska )
Bibliographie

Voyage to the Whales
Sperm Whales : Social Evolution in the Ocean
Les Clans des Cachalots
Sperm whales share patterned clicks to communicate
Les informations en français concernant la vie sociale et les cultures des cachalots sont malheureusement extrêmement rares, pour ne pas dire inexistantes. L’article en français de Wikipédia est truffé d’erreurs et totalement obsolète