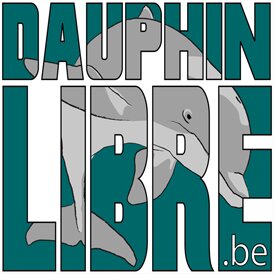Boudewijn Seapark, bientôt la fin ?
Boudewijn Seapark, bientôt la fin ? Un dossier écrit en 2012 mais qui reste toujours d’actualité.
En 2018, le delphinarium enferme encore 8 dauphins !
CONTEXTE HISTORIQUE
PREMIERS COMBATS
LUTTE FINALE
ET APRÈS ?
Dimensions
Le Boudewijn Seapark de Bruges dispose d’un bassin d’une capacité de 3 millions de litres d’eau, d’une longueur de 37 mètres de long et 13 mètres de large et d’une profondeur de 6 mètres pour 80% de sa surface, soit un mètre de plus que ce qu’exige la loi belge.
La surface du bassin est de 850 m2 et comprend un double bassin à l’arrière pour les mères et leurs nouveaux-nés, les malades ou pour les autres dauphins hors spectacle.
Deux petits basins de contention sont ménagés à l’avant, de chaque côté de la piscine dévolue au spectacle.
La vitre panoramique mesure 40 m de large, 6 centimètres d’épaisseur et 1,80 mètres de haut.
Cinq pompes assurent le filtrage de l’eau chlorée. 8 kilos de poissons sont donnés chaque jour à chaque dauphin.
Le bassin est totalement vide, privé de tout rocher, objet, ornement ou algue quelconque. Un poisson de mer ne saurait y survivre.
Des représentations ont lieu plusieurs fois par jour. Le décor représente un port de pêche des Caraïbes. (2012)
Contexte historique
Le Boudewijn Park a été inauguré en 1963.
L’emplacement du parc correspondait au lac dénommé à l’époque Cloetjesput.
Il s’agissait alors d’une salle de loisirs de quartier, avec plusieurs terrains de jeux, des courts de tennis, une piscine et un salon de thé.
Le Boudewijn Seapark proprement dit fut inauguré le 9 mai 1971, comme une annexe du site principal.
Son gestionnaire initial n’était autre que le Dolfinarium de Harderwijck et il ne devint propriété belge qu’en 1975.
Au printemps de l’année 1988, un atroce incendie ravagea entièrement les installations du delphinarium.
Trois dauphins au moins périrent sous les décombres, assommés par des poutres en flammes et suffoquées par la fumée.
Suite à cet incendie, le cirque aquatique rouvrit ses portes en 1990, sous la protection cette fois d’un solide dôme en béton, imperméable à la lumière du jour mais peu susceptible de s’enflammer à nouveau.
Les effectifs furent renouvelés, parmi lesquels figuraient notamment Puck, Roxanne, Terry, Tex, et Linda.
Jusqu’en 1988, il était en effet encore permis d’importer des dauphins capturés en mer, ce qui fut donc le cas de la plupart des captifs de Bruges. En 1999, suite à quelques naissances, onze dauphins se partagèrent bientôt l’espace confiné du bassin, qui ne devint un « zoo » qu’en 2009.
Géré jusqu’alors comme une petite entreprise familiale, le parc a été acquis en 2004 par le groupe espagnol Aspro Ocio, propriétaire de vingt-deux parcs aquatiques et parcs animaliers en Europe, dont douze disposent d’un aquarium. Boudewijn Park ouvrit en 2005, sous son nouveau nom, Boudewijn Seapark.
Depuis, de nombreux aménagements ont été faits et la rue séparant les dauphins des otaries, rapaces et autres perroquets, fut carrément achetée à la commune pour devenir domaine privé et interdire de la sorte toute manifestation d’opposants à la captivité sur son seuil !
Dès 2007, un « théâtre des otaries » s’était ajouté au parc , qui permit de délocaliser ces pinnipèdes du bassin des dauphins vers une piscine encore plus minuscule pendant l’été. Les phoques de la Mer du Nord – à deux pas du parc – occupent quant à eux une double vasque d’eau peu profonde. Ils se livrent également à des « shows pédagogiques ».
L’afflux d’argent amené par la compagnie espagnole a également permis au Boudewijn Seapark de s’offrir de façon massive la servile allégeance des médias, des politiques et des publicitaires, ainsi que de privatiser une rue qui servait aux manifestations. Le tout s’intègre aujourd’hui dans la nouvelle attraction, inaugurée en 2009, Bobo’s Indoor.
Ce parc couvert de plus de 2.000 m² contient une plaine de jeu avec une piscine à balles, un phare à escalader, des autos tamponneuses, et quelques animaux etc. Bobo’s Indoor a la particularité d’ouvrir toute l’année, contrairement aux autres attractions.

Décès
Selon les estimations les moins pessimistes, 30 dauphins sont morts dans l’enceinte du delphinarium depuis son ouverture. Sans doute plus, sans compter les déportations des captifs en surplus, expédiés vers des delphinariums sub-standards.
Mais aucune liste officielle de ces drames n’est fournie au public par l’entreprise commerciale.
Il faut pour l’obtenir se référer au sites de data base officieux.
SOMMAIRE

Premiers combats
Si les dauphins du Zoo d’Anvers firent l’objet d’une vaste campagne de soutien dès 1995, il fallut attendre la déportation des deux derniers survivants vers le delphinarium de Duisburg puis la mort de la delphine Iris à Duisburg en mars 2003 pour que l’attention se tourne enfin vers ce qui apparaissait alors comme une citadelle inexpugnable : le Boudewijn Seapark !
On le savait ardemment protégé par les politiciens sociaux-chrétiens majoritaires dans la région, qui voyaient en cette prison aquatique et y voient toujours aujourd’hui, une source de revenus et d’emplois indispensables à l’équilibre économique de la Flandre occidentale.
C’est le 11 juillet 2004, sur base d’un projet initial du gestionnaire de ce site, qu’aux côtés de l’association GAIA et avec l’aide précieuse de Ric O’Barry, de One Voice et de Bite Back, que la toute première manifestation de rue se tient devant les portes mêmes du delphinarium.
Cette manifestation particulièrement réussie mena le Parlement fédéral de Belgique à dépêcher une délégation de ses membres sur place, puis amena le député Thierry Giet à déposer une proposition de résolution de loi au terme de débats houleux qui suggérait l’interdiction de l’ouverture de tout nouveau delphinarium à l’avenir et un contrôle plus strict de ce qui se passait dans l’enceinte du parc.
La loi, faut-il le préciser, ne fut jamais votée.
Cette manifestation amena aussi à la mise en place d’une Commission spéciale pour le bien-être des dauphins de Bruges, placée sous la tutelle du Ministre de la santé publique et de la protection animale de l’époque, Rudy Demotte, qui interdit puis re-autorisa les cirques avec animaux avant de les interdire tout à fait !
Présidée par le Dr Erik Van der Straeten, cette Commission mettait en principe en présence, dans une ambiance glaciale, les défenseurs des dauphins, à savoir le Dr Gauthier Chapelle (Planète Vie), Véronique Servais (Université de Liège), Michel Vandenboch (Gaia), et le gestionnaire de ce site en tant que représentant d’un prémonitoire « Comité pour une Belgique sans Delphinarium ».
Seules les deux dernières personnes citées furent présentes à cette rencontre peu cordiale.
En face d’elles, se trouvaient en revanche, bien présents et en nombre, les défenseurs des delphinariums, à savoir Bart Dewever (directeur commercial du Boudewijn Seapark), Johann Cottyn (dresseur en chef), Thierry Jauniaux (spécialiste des nécropsies de cadavres e dauphins à l’Université de Liège) et le très incongru Dr Manuel Garcia Hartmann, vétérinaire du Zoo de Duisburg mais aussi de pas mal de delphinariums européens, dont celui de Bruges.
Cette commission devait en principe se fonder sur le rapport accablant du Dr Toni Frohoff, fruit d’une enquête financée par GAI et la WSPA, afin d’estimer l’état psychologique de dauphins de Bruges et leur environnement. Cette spécialiste internationale du comportement des cétacés écrivait en substance :
« Au cours de mes deux jours de visite au delphinarium, j’ai noté une série de comportements qui, sur la base des connaissances scientifiques disponibles et de mon expérience de vingt ans d’étude du comportement, indiquent une grande souffrance mentale et de grands risques pour la santé et la sécurité des animaux. Le delphinarium est clairement trop petit pour neuf dauphins (Ile nombre a été réduit à 7 en 2012, suite à la déportation de Linda et Mateo et à la mort de Flo). La superficie totale répond peut-être aux normes belges mais elle ne remplit pas, par exemple, les conditions légales applicables au Brésil.
Le delphinarium est tout à fait médiocre en comparaison avec d’autres delphinariums dans le monde, qui créent un environnement plus naturel pour les dauphins. Le delphinarium de Bruges est le plus bruyant de tous ceux que j’ai visité, ce qui est inacceptable quand on connaît la sensibilité auditive des dauphins.
Des risques inutiles sont pris en matière de sécurité des visiteurs qui peuvent toucher les animaux. Les dauphins sont imprévisibles, le danger de morsure est réel. Ce genre d’interactions avec les humains peut également provoquer des maladies, qui menacent la santé des dauphins.
« J’ai constaté un nombre d’agressions anormal : des dauphins qui se repoussent les uns les autres, se happent, se frappent des ailerons. Il est scientifiquement prouvé qu’en l’absence de possibilités de fuite, des blessures, de fortes tensions et des maladies peuvent apparaître.
J’ai été également surprise de constater autant de comportements liés au stress dans le bassin d’isolement, comme la nage en cercle, des coups corporels subits et stéréotypés, des inspirations profondes et répétées, un comportement de sollicitation de nourriture (ouvrir la bouche vers les visiteurs), des dauphins qui heurtaient les murs du bassin en vain et souvent, des gestes répétés, des coups de têtes brusques…« , etc.

Ce rapport fut froidement refusé comme non-pertinent par les représentants de l’Industrie présents à la Commission.
Il faut savoir par ailleurs que seuls les documents publiés en langue française ou néerlandaise étaient autorisées à cette table.
On sait que si les documents en langue anglaise condamnant de manière scientifique la détention des cétacés ne manquent pas, en revanche, la littérature francophone sur ce thème est extraordinairement rare pour ne pas dire inexistante. C’est que pour être cétologue, il faut faire des stages en delphinariums et que tout opposant à la captivité passe pour un traître dans ces milieux académiques.
Ce n’est pas le cas dans les pays anglo-saxons.
Du côté flamand, moins de soucis : l’Université d’Utrecht, payée pour ses travaux par le Delphinarium de Hardewijck, pouvait fournir tous les panégyriques que l’on voulait en faveur de la captivité.
La Commission ne connut dès lorsqu’une seule séance.
Le gestionnaire de ce site la quitta, dégoûté, et il n’y eut plus d’autre réunion.
Quelque temps plus tard, suite à sa demande, la députée ECOLO Zoé Génot accepta d’interpeller la Ministre Laurette Onkelinx, nouvellement nommée au poste qu’occupait son prédécesseur Rudy Demotte, afin de s’enquérir de l’évolution de cette fameuse commission spéciale.
Faute de combattants mais aussi de « l’apport trop restreint de données scientifiques par les membres », la Ministre avait décidé de confier au Conseil du Bien-être des Animaux la tâche de reprendre les travaux en présence des mêmes « spécialistes » afin d’étudier la possibilité de modifier les normes minimales prévues par la loi belge en ce qui concerne les dauphins captifs.
« Le Conseil est un organe de concertation et d’avis instauré au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Cet organe remet des avis au Ministre de la Santé publique et au Service du Bien-être animal. Ces avis portent sur différentes questions relevant du bien-être animal comme, par exemple, la castration douloureuse des porcelets ou la caudotomie (amputation de la queue) des chevaux.
Le Conseil est composé de représentants issus d’organisations pour les droits des animaux, d’associations de consommateurs, d’organisations agricoles, d’associations de vétérinaires, de commerçants et d’éleveurs d’animaux. Un président et un bureau de cinq scientifiques siègent à la tête du Conseil« .
La décision fut prise en 2009.
En 2010, sous la tutelle du Conseil du Bien-être des Animaux, donc, des organisations de défense animale se retrouvent donc à nouveau en des représentants du delphinarium de Bruges, selon des informations reçues directement du SPF Santé Publique, que nous avons interrogé. Les débats seraient toujours en cours.
SOMMAIRE

La lutte finale
Pourquoi perdre en effet autant de temps à négocier sur des normes obsolètes ou sur une éventuelle amélioration du delphinarium alors que la captivité des dauphins constitue en soi une forme aggravée de maltraitance et qu’elle ne répond même pas aux exigences légales les plus élémentaires ?
En Belgique, le fait de détenir de tels êtres dans de telles conditions va donc directement à l’encontre des prescriptions de la Loi du 14 août 1986, modifiée par les lois du 26 mars 1993 et du 4 mai 1995, relative à la protection et au bien-être des animaux et dont l’article 4 contient des dispositions importantes :
« Toute personne qui détient un animal, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l’animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d’adaptation ou de domestication ».
Par ailleurs, selon la Directive 1999/22/CE du Conseil de l’Europe du 29 mars 1999 relative. la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique, tous les zoos et donc les delphinariums reconnus comme tels (ce qui est le cas en Belgique mais pas en Bulgarie, où ceux-ci sont considérés comme des cirques !) doivent prendre part à des activités de conservation, de recherche et d’éducation censées bénéficier à la préservation des espèces menacées. (Article 3)
Il est frappant d’apprendre que le delphinarium de Harderwjick aussi bien que le Boudewijn Seapark de Bruges ont tout simplement refusé de transmettre toute information relative à leurs activités dans ce domaine aux enquêteurs mandatés par Born Free/Endcap/WDCS dans le cadre de la rédaction de leurs deux rapports, l’un concernant les zoos en général, l’autre les delphinariums de manière plus particulière.
Il était donc impossible aux rédacteurs de ces deux rapports de se faire une opinion sur la validité des actions entreprises (ou non) par le Boudewijn Seapark. Notons que 21 delphinariums européens ont adopté la même attitude : refus de transmettre la moindre information !
Une telle attitude ne plaide certes pas en faveur d’une entreprise reconnue par Loi belge en tant que zoo en 2009, encensée par l’EEAM et contrôlée par la Vlaams Agentschap voor Natuur en Bosqui renouvelle chaque année son autorisation au parc à détenir un maximum de sept dauphins et de sept otaries.
Une visite au Boudewijn Seapark ou la simple consultation de son site web officiel permet cependant de constater qu’à l’instar de tous les autres delphinariums européens, cette entreprise commerciale ne contribue pas ou infiniment peu à la conservation de la biodiversité et ne fournit pas aux cétacés détenus les conditions de vie adéquats à leurs besoins étho-physiologiques.

Les morts précoces des dauphins nés captifs et le faible succès de la reproduction en bassin rendent la population des cétacés esclaves « non durable ».
D’autre part, aucune remise en mer de dauphins Tursiops captifs n’a jamais été effectuée par aucun delphinarium européen et moins encore par le delphinarium de Bruges (Le Dofinarium de Hardewijck libérant pour sa part des marsouins échoués puis soignés).
Ajoutons à cela qu’aucun bassin au monde n’est raisonnablement à même de reproduire les stimulations et l’enrichissement environnementales dont ces animaux extrêmement mobiles, hautement socialisés et liés entre eux par des liens familiaux ou amicaux très intenses, ont besoin, ce que la Directive européenne exige pourtant.
Sachant que le bassin principal du Boudewijn Seapark mesure 37 mètres de long et 13 mètres de large, que sa profondeur est de 6mètres pour 80% de sa superficie – soit un mètre de plus que ce qu’exige la loi, on se doute qu’il ne saurait répondre aux réelles exigences des dauphins Tursiops en termes d’environnement.
Ceux-ci disposent en liberté d’espaces vitaux qui peuvent atteindre 300 km et certains ont même été suivis parcourant des distances de 1.076 km en 20 jours (Frohoff et Packard, 1995).
Un bassin profond de 6 mètres et totalement vide de tout objet ne saurait non plus satisfaire des cétacés qui peuvent descendre sous 300, voire 500 mètres !

Le refus du Boudewijn Seapark de révéler ses secrets est donc bien compréhensible.
Comment justifier en effet la mort par suffocation de Terry et Skippy en 2000, sujettes à une infection fulgurante de candida albicans, ce champignon qui s’attaque à l’évent ?
Comment expliquer, par exemple, qu’après la mort suspecte de Flo, dont le cadavre avait été envoyé à Gand pour nécropsie, aucun rapport scientifique relatif à ce décès n’ait jamais été rendu public ?
Comment s’étonner que l’herpès dont a été victime la petite delphine Yotta n’ait pas été révélée au grand public, alors même que ce virus est transmissible à l’homme et que des enfants sont régulièrement invités, contre paiement, à caresser l’animal ?
Comment ne pas attribuer la cécité partielle de la pauvre Puck à la présence de chlore dans l’eau qui a fini par lui ronger la cornée ?
Quant au reste, il apparaît qu’en mai 2012, soit deux ans après la parution des rapports Born Free/WDCS, aucune des recommandations n’a été suivie du moindre changement.
Si la musique est peut-être un peu moins « tonitruante » selon les shows, ces derniers sont toujours aussi anthropomorphiques que par le passé (ballet esthétique des dauphins avec les dresseurs sous l’eau, dresseur chevauchant un dauphin en mouvement, jet de ballons vers les enfants dans la salle, etc. ) et ne reflètent en rien le comportement naturel des dauphins sauvages.
Pédagogie
Pour autant que nous ayons pu en juger, du fait de la très mauvaise qualité sonore des commentaires diffusés par haut-parleurs, les informations pédagogiques destinées au public se limitaient encore et toujours au fait que les dauphins n’étaient pas des poissons, qu’ils n’avaient pas de branchies et qu’ils allaitaient leurs petits.
Il est vrai qu’en payant une somme considérable, on peut participer à un programme «proche des dauphins» d’une durée de 60 minutes.
Qu’y apprend-t-on ?
Durant 30 à 40 minutes, un dresseur explique les dangers des filets dérivants – mais pas celui des captures pour les delphinariums menées dans le monde entier, sauf e Europe et aux États-unis, on s’en doute – puis quelques généralités sur les cétacés, à savoir : l’évolution, les mysticètes et les odontocètes, les diverses espèces de dauphins, les différences entre mâle et femelle. Les 20 dernières minutes sont constituées par la présentation des prisonniers du delphinarium et la description des techniques de dressage pour les shows et les soins médicaux. Voilà. Vous savez tout des dauphins !
Quant aux recherches, elles se sont limitées à :
– la participation à un projet européen en 2006 destiné à développer une méthode permettant de réduire la prise accessoire (bycatch) de dauphins dans les filets dérivants, en partenariat avec Seamarco (Harderwijck) qui a mené de façon plus professionnelle les mêmes recherches.
Pour Bruges, celles-ci se limitées à l’entraînement du petit dauphin Milo, fils de Linda, et à observer ses réactions aux répulsifs acoustiques.
Pas de chance pour ce pauvre Milo : comme tant d’autres nés-captifs, il est mort durant un acte chirurgical consécutif une infection dentaire à l’âge de 8 ans. Par ailleurs, la technique des «répulsifs sonores» s’est révélée au cours du temps totalement inutile, du fait de les cétacés étaient attirés par les signaux d’avertissement indiquant le passage du poisson !
– une étude de plusieurs années sur la grossesse des dauphins qui a permis de développer un logiciel destiné à calculer et prédire la date de naissance des bébés dauphins. Ce logiciel est devenu une référence internationale pour les autres delphinariums internationaux. Une recherche qui ne contribue pas vraiment à la sauvegarde des dauphins libres.
C’est tout ? Non ! Le Boudewijn Seapark de Bruges dispose d’un centre de formation pour les dresseurs.
Ceux-ci donnent également des conférences à propos des mammifères marins (captifs) au ‘Hogschool Gent Departement Bachelor Biotechniques. Là où l’on apprend comment élever des vaches, aussi..
Pas un mot sur l’éthologie cognitive, on s‘en doute.
Pas un geste en faveur des mammifères marins échoués sur la côte belge, si ce n’est la participation financière lilliputienne aux projets d’une fumeuse fondation intitulée Dolphin Fund (Pays-Bas !).
On notera que les prétendues recherches sur la delphinothérapie sont désormais devenues des actions sociales en faveur des enfants malades (revalidation des enfants de l’UZ Gent, collaboration avec Make-a-Wish, Dreams4kids, Ligue Braille et autres activités caritatives qui ne bénéficient qu’à l’être humain.

Nous sommes donc à des miles marins de toute préservation de l’espèce et du renforcement des populations sauvages in situ, qui sont pourtant en principe les principales missions légalement attribuées à ce prétendu «zoo».
Faut-il chercher plus loin ?
Est-il normal, est-il éthique d’enfermer des dauphins leur vie entière dans un espace minuscule où ni une algue ni un poisson ni un coquillage ne pourrait survivre ?
La captivité EST une maltraitance.
Bien sûr, aucun dresseur de Bruges ne frappe les dauphins à coups de batte ou ne s’amuse à leur écraser des mégots de cigarettes sur la peau. Ils en prennent soin du mieux qu’ils peuvent. Et des liens affectifs se nouent très certainement entre les geôliers et leurs captifs.
Mais ils les nourrissent avec des poissons morts enrichis de vitamines alimentaires (thiamine, létale à doses trop fortes), antidépresseurs, calmants, eau ajoutée (les poissons gelés se dessèchent) et des quantités impressionnantes d’antibiotiques pour empêcher les innombrables maladies bactériennes consécutives au mode de vie malsain dans une eau chlorée, filtrée, dévitalisée, salée artificiellement et chimiquement ré-enrichie. Ces détails n’ont rien de secret. On peut les trouver dans n’importe quelle étude relative à l’élevage de dauphins en bassin.
« Les médicaments tels que vitamines ou antibiotiques sont injectés par une seringue via un tuyau de caoutchouc lubrifié inséré dans la gorge de l’animal».

Par ailleurs, les mêmes dresseurs sont chargés de faire se reproduire les dauphins comme des cochons de batterie. Un mâle est amené de l’extérieur (Beachie dans le cas présent) que les femelles ne connaissent pas et qu’elles n’ont pas choisi au termes des pariades amoureuses et des luttes entre concurrents mâles comme c’est le cas en mer.
Les femelles sont engrossées quand le Boudewijn Seapark le décide, ou bien reçoivent des traitements anticonceptionnels quand le moment n’est pas venu. Le but est évidemment de produire de temps à autre un mignon bébé, dont on sait que la seule présence peut faire exploser le chiffre d’affaires du cirque aquatique de manière exponentielle et renflouer ses caisses parfois défaillantes.
Lorsque trop de bébés viennent à naître, il faut s’en débarrasser car la loi belge ne permet plus que 7 dauphins et 7 otaries.
Dès lors, le surplus est expédié sans état d’âme vers des établissements portugais, italiens ou espagnols sub-standards, sans qu’aucun compte soit tenu des liens familiaux ou d’amitié qui unissent les individus séparés.
Linda, qui fut capturée en même temps que Roxanne, a été ainsi déporté dans une sorte de caisse métallique à Gènes, en compagnie de son fils Mateo.
Ils s’y trouvent toujours seuls, mère et enfant, ce qui est en principe strictement interdit , le nombre minimum de dauphins étant fixé par la loi belge de trois à cinq.
Faut-il rappeler que la Croatie a interdit tout delphinarium sur son territoire sans en avoir jamais possédé un seul ?
Et ceci pour la seule raison que cette pratique a été jugée trop cruelle en soi !
Il en fut de même naguère pour la Norvège et l’état du Queensland en Australie.
La fermeture du Boudewijn Seapark et l’interdiction ultérieure de tout établissement de ce type sur le territoire belge sont d’abord et avant tout une question d’éthique.

Il n’est plus concevable aujourd’hui d’imposer une vie monotone et confinée à des êtres dont la science s’accorde à dire aujourd’hui qu’il est le mammifère le plus intelligent et le plus socialisé de cette planète après – ou avec – l’Homme.
Si l’on peut à la rigueur satisfaire de manière imparfaite les besoins éthocognitifs des éléphants ou des grands singes dans un parc animalier de grande taille, la chose est strictement impossible, rappelons-le une fois encore – quand il s’agit de PERSONNES à part entière dotés de conscience de soi, de cultures, de vie sociale complexe et même d’un langage récursif articulé, plus complexe que la langue chinoise !
Car s’il est bien évident que les grands singes sont nos frères biologiques les plus proches, ainsi que l’analyse génétique vient de nous le prouver de façon définitive, ne faudrait-il pas considérer les cétacés (et les odontocètes en particulier) en tant que nos frères psychiques ?
Leurs capacités cognitives, que génère un encéphale géant exceptionnellement riche en circonvolutions, semblent en effet identiques, voire supérieures aux nôtres, en termes de complexité et de puissance de calcul.
Leurs vies sociales, leurs organisations politiques, leurs langages, leurs techniques de chasse et leurs facultés d’adaptation aux modifications du milieu révèlent une inventivité sans aucun équivalent dans le monde animal.
Le vrai combat contre les delphinariums devrait donc s’appuyer d’abord et avant tout sur de telles données.
Quelque que soit la taille des bassins, minuscule ou immense, que la captivité leur impose, ces prisons restent invariablement vides et nues dans le seul but de de créer un ennui artificiel et de contraindre le détenu à remonter en surface pour y exécuter des shows.
Ce n’est pas ainsi que vivent les vrais dauphins. Leur place n’est pas dans une prison, ni dans une ferme d’élevage.
Leur destin n’est pas de devenir une nouvelle race de « chiens marins » domestiquée par l’Homme.
Les cétacés sont des gens.
Des individus à part entière, comme vous et moi, soucieux de leur famille, de leurs amis et de leur avenir.
Ce sont les «Peuples premiers» de l’Océan qui ont le droit de vivre libres et dont il importe aujourd’hui de protéger les territoires naturels, tout autant que la libre circulation dans les territoires dominés par l’homme.
Voilà ce que devraient dire aux membres du Conseil du Bien-être des Animaux les représentants des trois associations défendant la cause des dauphins de Bruges !Et crier aux oreilles de la Ministre en charge ces mots terribles :
« Au-delà du traumatisme dévastateur que représente une capture en mer, il existe une souffrance inhérente au fait d’être simplement emprisonné, laquelle réduit la société hautement évoluée des dauphins à un «pecking order», cette organisation primitive des poules de basse-cour, où les individus les plus forts et les plus agressifs se battent pour la suprématie et infligent aux plus faibles d’entre eux la soumission, la maladie ou la mort.
A la tyrannie de leurs propres compagnons de bassin s’ajoute celle de leur dresseur humain, ainsi que le stress que constitue les shows exécutés de trois à cinq fois par jour devant une foule bruyante, les méthodes de dressage impliquant la privation de nourriture et les récompenses du même ordre, qui ont pour conséquence de démultiplier encore la jalousie et la compétition au sein du groupe restreint des captifs.
Des études récentes menées aux USA démontrent qu’un nombre excessif de dauphins captifs succombent à des maladies directement liées au stress, telles que les crises cardiaques et les ulcères gastriques. On doute qu’il s’agisse d’une coïncidence : des millions d’êtres humains forcés de supporter un travail servile pénible et répétitif souffrent exactement des mêmes maux.
L’agression interindividuelle n’est cependant pas la seule cause de ces décès prématurés. Elle n’est qu’un aspect d’une désocialisation plus globale, selon les mots mêmes de spécialistes de la captivité tels que Giorgio Pilleri, une acculturation profonde qui oblige les dauphins à s’adapter au moule de la société humaine, hautement hiérarchique.
Alors qu’en mer libre, les dauphins chassent en coopération étroite, rabattant ensemble les poissons et se les partageant en toute égalité, en captivité, ils développent les défauts même de la société humaine : égoïsme aigu, compétition, sadisme ».
Rose Tinted Menagerie