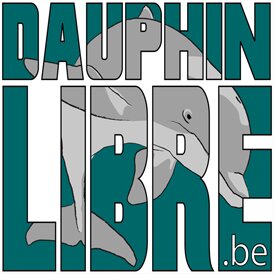Akeakamai et les dauphins savants
Akeakamai et les dauphins savants qu’étaient devenus Elele, Phoenix et Hiapo avaient été capturés dans le Golfe de Floride. Un long voyage les amena jusqu’à Hawaï, au Kewalo Basin Marine Mammal Laboratory du Dr Louis Herman.
Pendant 30 ans, le Dr Herman s’est consacré à l’étude du potentiel cognitif des dauphins et de leur capacité de compréhension du langage humain.
On l’aura compris : le delphinien tel qu’on le parle n’intéressait guère le Dr Herman. L’US Navy finançait ses travaux, et c’était avant tout le degré de compréhension des ordres qui passionnait ses commanditaires.
Chacun des 4 derniers dauphins qui vécurent au Kewalo Basin était devenu un genre de savant dans sa branche ou plutôt, selon la conception étonnamment colonialiste du Dr Herman, il avait été amené à un « niveau supérieur ».
« Pour que nous puissions atteindre ce que nous avons ici, il a fallu une éducation spéciale à long terme des dauphins dans un environnement approprié », disait-il dans une interview.
« Si le martien proverbial débarquait sur Terre et inspectait une tribu primitive de Nouvelle-Guinée en tant que représentant d’Homo sapiens, il tirerait des conclusions très différentes sur le potentiel intellectuel d’Homo sapiens que s’il débarquait dans la Silicon Valley. Pourtant, ce potentiel réside autant chez le primitif originaire de Nouvelle-Guinée que chez le spécialiste de la Silicon Valley.
Il s’agit simplement de réaliser ce potentiel grâce à l’éducation et à la culture. »

Elele et son dresseur
Mais ni l’éducation ni la culture ne protègent les dauphins captifs d’une fin précoce.
Nos quatre savants à nageoires moururent l’un après l’autre, alors même que leurs conditions de détention étaient excellentes, selon les critères du métier.
– Elele mourut d’une infection abdominale le 16 décembre 2000.
– Akeakamai a été euthanasiée, suite à son cancer à la mâchoire, en date du 2 novembre 2003.
– Phoenix l’a suivie de peu dans la mort le 13 janvier 2004, sans raison apparente.
– Puis ce fut le tour de ce pauvre Hiapo resté seul et qui n’a donc pas tardé à se laisser mourir le 24 février 2004.
Aucun des quatre n’avait atteint l’âge de 30 ans…

Akeakamai
Akeakamai et la compréhension du langage chez le dauphin
Grâce à des séances d’entraînement dans deux bassins circulaires connectés, les dauphins ont appris une série de noms, de modificateurs et de verbes. Herman combinait les mots en commandes et testait leur compréhension en observant leurs réponses.
Les nouvelles commandes étaient créées par de nouvelles combinaisons de mots ou par un réarrangement des mots selon des règles grammaticales. Une réponse correcte indiquait que les dauphins comprenaient la syntaxe ou comment l’ordre des mots affectait leur sens pour eux. Par exemple, la commande « Récupérer le cerceau et l’amener jusqu’au frisbee » signifie autre chose que « récupérer le frisbee et l’amener au cerceau« , même si les mots sont les mêmes.
Créer des phrases
La question de savoir si les animaux peuvent créer ou comprendre des phrases a longtemps été une question ouverte dans la recherche scientifique. Il faudra peut-être des années pour déterminer si les dauphins sont capables de produire un langage, a déclaré Herman, mais ses dauphins fournissent déjà l’équivalent de réponses « oui » ou « non ».
« Nous avons cherché à savoir ce qui se passerait si nous donnions l’ordre à un dauphin de sauter par-dessus le ballon, mais qu’il n’y aurait pas de ballon », expliquait Herman. « Le dauphin a cherché le ballon dans les deux bassins pendant 50 secondes, puis il est revenu lentement vers son dresseur comme pour dire: » Ce n’est pas là ».
« C’est une étape assez importante dans ce travail avec ces animaux: le fait qu’ils puissent vous faire rapport sur ce qui existe et ce qui n’existe pas » renchérissait Herman. « De cette façon, le dauphin nous révèle le contenu de son monde immédiat. »
Deux petits panneaux ont d’ailleurs été installés au bord de la piscine où Ake peut indiquer les réponses « oui » ou « non ».

Ake dit « oui » Photo Dolphin Institute
Phoenix a subi des tests d’identification visuelle, avec notamment une tondeuse à gazon, un panier à linge et un tuyau d’égout.
Un assistant tenait les objet pendant quelques secondes, puis l’emportait au loin. Un peu plus, les chercheurs ont replacé l’objet près du bassin, entre deux autres nouveaux objets. Lorsque Phoenix a nagé jusqu’à lui, un poisson l’a récompensée.
Ces expériences sur la mémoire des dauphins indiquent que ceux-ci n’ont aucune difficulté à se souvenir de ce qui leur est montré plus d’une minute plus tôt, mais que leur capacité d’attention est courte. Ce qu’on peut comprendre, vu le peu d’intérêt que présente une tondeuse à gazon pour un dauphin.
« Après un moment, le dauphin se met en colère », reconnaissait Herman.
À une autre occasion, les cerceaux ronds ont été remplacés par des cerceaux carrés, de grands paniers par des petits paniers et différents types de balles ont été utilisés. Le fait de modifier des objets particuliers n’a pas affecté de manière significative la capacité des dauphins à répondre aux commandes, ce qui indique que pour eux comme pour nous, un panier est un panier, qu’il soit grand, petit, rond ou carré.
« Nous voulions savoir si la compréhension du mot par un dauphin était aussi large que la nôtre », a déclaré l’un des chercheurs.
« Apparemment c’est le cas ».

Phoenix et Akeakamai
Les recherches ont commencé peu après qu’Akeakamai et Phoenix aient été capturées à moins d’un mile de distance, le même jour d’été de 1978 près de Gulfport, dans le golfe du Mexique.
Toutes était âgées de trois ans à peine Ils avaient tous deux environ 2 ou 3 ans à l’époque.
Au cours des années suivantes, les deux dauphins ont suivi une formation différente au centre de recherche d’Hawaii. Pour Phoenix, un langage audio artificiel a été créé. Akeakamai a été formé à un langage gestuel.
En outre, on a enseigné à Phoenix une grammaire linéaire dans laquelle l’objet direct venait en premier, suivi du verbe et ensuite de l’objet indirect. La grammaire donnée à Akeakamai était non linéaire: l’objet indirect venait en premier, suivi de l’objet direct et enfin du verbe.
Le langage d’Ake était considéré comme plus difficile, dans la mesure où elle doit d’abord voir, mémoriser et analyser les parties de la phrase avant d’en saisir le sens.
Les dresseurs portaient des lunettes noires, afin de ne révéler aucun mouvement des yeux vers la cible et se tenaient immobiles, à l’exception des mains. Les dauphins se montrèrent capables de reconnaître les signaux du langage gestuels aussi bien lorsqu’il étaient filmés puis rediffusés sur un écran vidéo que lorsque ces mêmes signes étaient exécutés à l’air libre par l’entraîneur. Même le fait de ne montrer que des mains pâles sur un fond noir ou des taches de lumière blanche reproduisant la dynamique des mains, a largement suffi aux dauphins pour comprendre le message !
Herman a déclaré que, à long terme, ses recherches pourraient aboutir à un dialogue réciproque entre l’homme et le dauphin.
« En théorie », a-t-il dit, « nous pourrions demander: dites-nous comment est votre société, comment communiquez-vous les uns avec les autres? Quels sont les messages que vous envoyez et recevez? Comment déterminez-vous votre migration? est-ce que c’est comme être un dauphin? Mais, en réalité, cela ressemble plus à de la science fiction qu’à de la vraie science ».
Dommage…

Les rapports entre dauphins et dresseurs étaient souvent empreints de bonne humeur voir de franche rigolade, malgré le contexte carcéral
On le voit, les travaux de Louis Herman, financés par la US Navy, concentraient essentiellement sur la « compréhension passive » du langage bien plus que sur sa production par le dauphin.
Herman expliquait son choix par le fait que la compréhension est le premier signe d’une compétence linguistique chez les jeunes enfants et qu’elle seule peut être testée de façon rigoureuse.
La structure grammaticale qui fondait ces langages enseignés s’inspirait de celle de l’anglais. Certains chercheurs ont noté qu’il aurait été mieux venu de s’inspirer davantage de langues à tons ou à flexions, comme le chinois, dont la grammaire simple et l’usage d’idéogrammes aurait parue plus familière aux cétacés.
Ken Levasseur, qui travailla dans ce laboratoire, regrette aussi le côté mécanique des apprentissages, qui ne laissaient aucune place à l’inventivité naturelle des dauphins et aucun compte des sons naturellement émis par eux.
Désespéré de voir ces dauphins sauter en regardant la mer toute proche, il libéra Kea and Puka lors d’une nuit sans lune avec quelques amis. Et perdit son emploi, comme on s’en doute.
Aucun rapport, donc, entre les travaux de Louis Herman et ceux de Vladimir Markov, qui portaient sur des dauphins sauvages, à ceci près qu’ils prouvent tous deux que les odontocètes sont capables de manier la grammaire et de faire usage d’un vocabulaire. Mais des captures sauvages dans les deux cas, au nom de la recherche scientifique.
Les dauphins ne devraient travailler avec nous que s’ils le choisissent librement. Ils doivent être nos partenaires, pas nos esclaves. Certains dauphins ex-ambassadeurs le proposent d’ailleurs fort souvent. Mais on les chasse sous prétexte qu’ils violeraient les baigneuses !

Ake et Phoenix étaient deux amies très proches. Le décès de l’une a entraîné celui de l’autre.
5 novembre 2003
Ake est morte dans les bras de ses soigneurs
Les chercheurs et le personnel du Laboratoire de recherches sur les mammifères marin du Kewalo Basin pleurent aujourd’hui la mort de l’une de leurs résidentes parmi les plus aimables et les plus connues, une delphine Tursiops âgée de 27 ans du nom d’Akeakamai.
« Ake est morte un dimanche pendant la nuit, entourée de tous ses amis qui la tenaient dans leurs bras, l’embrassaient, la couvraient de larmes et la caressaient doucement » a raconté Louis Herman, psychologue à l’Université d’Hawaï qui a fondé et dirige aujourd’hui le Kewalo Basin. « Durant toute son existence en notre compagnie, c’est vraiment le dauphin qui nous a mené le plus loin dans la connaissance des capacités cognitives et communicationnelles des cétacés« .
Akeakamai – « Amoureuse de la sagesse » en langue hawaïenne – ainsi que Phoenix, un autre dauphin femelle, ont toutes deux été capturées dans le Golfe du Mexique puis amenées par Louis Herman jusqu’en Polynésie, en 1976.
Alors âgées d’environ un an et demi chacune, ces deux delphines ont grandement contribué à une meilleure connaissance scientifique de l’intelligence des dauphin, de leurs perceptions sensorielles et de leur langage.
Ake s’est en outre rendue utile à la recherche vétérinaire sur les animaux captifs, puisqu’elle luttait depuis cinq ans contre son cancer de la bouche. Le Dr. Carolyn McKinnie, le vétérinaire du laboratoire, avait tenté divers traitements mais la tumeur ne pouvait être éliminée.
Le 16 août dernier, la delphine a subi une opération médicale exceptionnelle, menée au sein même du laboratoire par le Dr.John Lederer, directeur médical du Nae’a Radiation Oncology Department au sein du Queen’s Medical Center.
Celui-ci a traité la tumeur par le biais d’une technique appelée « brachythérapie », qui consiste en l’implantation de « graines radioactives » au sein même de la tumeur. On utilise cette technique pour les patients atteints du cancer de la prostate, mais elle n’avait jamais été encore appliquée à un animal. Herman a insisté sur le fait que la tumeur avait effectivement régressée mais que des complications étaient survenues, sans doute associées en partie au traitement antibiotique à long terme que reçoivent tous les dauphins captifs pour les préserver d’une invasion bactérienne.

Lou Herman au Kewalo Marine Laboratory avec la delphine Akekamai., alors âgée de 24 ans. Photo Ken Sakamoto
La delphine était particulièrement sensible aux attaques de E. coli, qui ne peut être combattue qu’à l’aide de deux antibiotiques. « Mais nous sommes parvenus à contrôler le problème » a déclaré Herman. « Cependant, Ake est devenue de plus en plus faible en raison du climat de stress qu’elle devait endurer lors de ces examens et de ces traitements médicaux.
Vers la fin, elle a commencé à avoir du mal à respirer. Quelques semaines plus tôt, le dauphin mâle Hiapo s’était fâché sur elle et lui avait donné un grand coup de caudale, ce qui a provoqué chez Ake une petite hémorragie interne au niveau de sa cage thoracique, qui a rendu pénibles les mouvements de ses poumons« .
Herman a encore raconté qu’à 5:30 heures du matin, ce dimanche, il a reçu un appel urgent du laboratoire.
Ake se tenait au milieu du canal reliant les deux bassins et le personnel était en train de lui administrer de l’oxygène par l’évent pour soutenir ses efforts respiratoires.
« Toute la journée, Ake s’est reposée dans le canal, la tête posée dans mon giron, soutenue par tous ses amis. C’est un
animal d’une force incroyable et tellement présente dans nos cœurs, nous avons voulu lui donner toutes les chances de survivre jusqu’au bout »
À 18 heures, Louis Herman s’est résolu pourtant à prendre une décision difficile, avec l’accord de tous les soigneurs.
« Nous nous sommes tous réunis autour d’elle, nous lui avons dit notre dernier « Aloha » (Adieu en Hawaïen).
Tout le monde s’étreignaient en pleurant dans les bras l’un de l’autre… »
La petite Ake a reçu alors un sédatif et « tout simplement, elle s’est endormie », a conclu Herman.
Ake sera incinérée et ses cendres rendues pour toujours à l’océan lors d’une cérémonie privée.
Louis Herman a indiqué que le laboratoire a reçu des appels et des fleurs de la part de nombreux autres laboratoires et de chercheurs partout dans le monde.
« C’est tout simplement incroyable comme le sort d’Akeakamai a pu toucher tant de personnes… Toutes se disent choquées et attristées par son décès »
Adapté d’un article de Helen Alton publié dans le Star Bulletin

Phoenix, 27 ans
19 janvier 2004
Phoenix n’a pas supporté la mort de son amie
Phoenix, le dauphin femelle de 27 ans maintenue captive au Kewalo Basin à Hawai, vient de décéder à son tour samedi dernier, deux mois à peine après le décès de sa grande amie Akeakamai.
Celle-ci, rappelons-le, fut euthanasiée suite aux terribles souffrances que lui causait son cancer à la mâchoire.
Bien qu’une tumeur ait également été décelée à l’intérieur de la bouche de Phoenix, aucun lien entre ces deux types de cancer ne semble encore avoir été découvert, selon le porte-parole du bassin concerné, Jim Manke.
Les autopsies sensées fournir une explication à la mort de ces deux dauphins sont toujours en cours et vivement attendues par les défenseurs des animaux.
Parmi ceux-ci, Cathy Goeggel, directeur de recherche au sein de l’association « Droits des animaux à Hawaii » a déclaré qu’elle se sentait particulièrement préoccupée par la situation du dernier dauphin prisonnier, désormais seul dans son bassin. Il s’agit du dauphin Hiapo, un nom qui signifie « Mâle premier-né » en langue hawaÏenne.
En 2002, Mme Goeggel s’était déjà jointe aux douzaines de protestataires qui voulaient libérer les trois derniers sujets d’expérience de Louis Herman.
Dès 1977, Ken LeVasseur, un chercheur indépendant, avait été condamné pour « vol au premier degré » après avoir libéré deux dauphins du laboratoire du Kewalo Basin. En 2002, Ken avait également attiré l’attention du public sur rapport du Ministère de l’Agriculture des USA signalant que cet établissement de recherches n’était pas conforme aux règlements en vigueur sur les delphinariums.

Hiapo
24 février 2004
Hiapo s’est-il suicidé ?
Hiapo a été retrouvé mort, flottant dans son bassin, ce 24 février à l’aube.
Sa mort n’a été provoquée, semble-t-il, par aucune cause physiologique précise et toute l’équipe du laboratoire de recherches s’accordait à dire que ce vigoureux jeune mâle de vingt ans était en excellente santé.
Pour eux, ce décès est une surprise totale.
Sans doute ces chercheurs n’ont-ils jamais entendu parler des liens d’amitié entre les dauphins ni de leur capacité à commettre un suicide. D’après Ric O’Barry, qui a vu mourir de cette manière la petite delphine Cathy, les cétacés semblent pourtant capables de « s’auto-asphyxier » de manière volontaire quand le stress qu’ils subissent atteint un niveau trop élevé. On connaît également les histoires de ces orques ou de ces globicéphales captifs qui se sont tapé le crâne sur le mur de leur bassin jusqu’à ce mort s’ensuive. La solitude et la captivité ne font jamais bon ménage et il n’y a rien d’étonnant à ce que des êtres dotés de conscience, de cultures et de langages choisissent de renoncer à la vie quand elle devient insupportable.
Carolyn J. McKinnie, la vétérinaire du Kewalo Bassin a pour sa part été remerciée le 29 janvier dernier. On suppose que la présence d’un ultime dauphin, de toutes façons condamné à mourir, ne justifiait pas de garder sous contrat un vétérinaire à plein temps.
De la même manière, Adam A. Pack, directeur associé du Basin Marine Mammal Laboratory et Vice-president du Dolphin Institute affirme aujourd’hui que c’est le licenciement des dresseurs habituels de Hiapo qui a précipité sa mort.
L’idée de reprendre de nouveaux dauphins pour remplacer les morts effleura l’esprit des chercheurs mais fut vite abandonné devant la fronde des activistes. Les activités de recherches furent donc poursuivies sur un mode mineur au Dolphin Institute de Honolulu, jusqu’àce jour.

Louis Herman mourut plus vieux que ses dauphins, à l’âge de 86 ans
Pourquoi Disney fait des recherches sur les dauphins captifs
La synchronisation des gestes et du souffle chez les dauphins